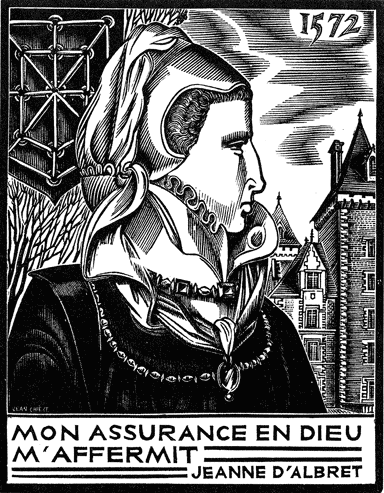
Freddy Malot – mars 1999
Église Réaliste Mondiale
________
Éditions de l’Évidence – 2010
2 montée de la Rochette, 69 300 Caluire
Ménage Privé
I
Quel Patriarcat ?
Primitifs
Civilisés
Communistes
Ménage Privé
1- Les Époux :
2- L’Homme :
Écologie
Marchandise-Richesse
Mentalités
II
Matriarcat
Races
Les Sémites selon les Rabbins
Document : De l’harmonie entre l’Église et la Synagogue
Fécondité et Matriarcat
Sarah
Ismaël
Rebecca
Isaac
Document : Louis de Bonald, “Condorcet” – 1795
Âge de Pierre, âge d’abondance
1- Les Colons :
2- Sahlins :
3- Analyse :
4- Les Jésuites :
“Romulus” et le Ménage Privé
Abbé Gaume : Histoire de la Société domestique
Saint Augustin : la Cité de Dieu
Islam et Vendetta
- Document : Origines de l’organisation judiciaire musulmane – la judicature
- Document : Histoire des révolutions de Corse, depuis ses premiers habitants jusqu’à nos jours
III
Cliques Néo-Barbares
Comte – Proudhon
1845
Progrès… Justice !
Auguste Comte : Grand Larousse
Auguste Comte : “Cours de 1842”
P. J. Proudhon : le groupe familial
IV
Le Patriarcat
Laïcité et Sexologie : le cas “Josette”
La Carmagnole
________
________
En Occident, on a pris l’habitude de lier l’idée de “patriarcat” aux Patriarches bibliques. Ces derniers sont assimilés aux chefs de tribus d’éleveurs nomades, et le type en est fourni par Abraham, donné comme l’ancêtre des Hébreux.
Or, à l’apogée des Temps Modernes, à la faveur de la Révolution française, le mouvement Féministe conséquent s’est déclaré. Mary Wollstonecraft y a attaché son nom, avec son livre : “Défense des Droits de la Femme”, écrit en 1791 et adressé à Talleyrand. Elle y dit : “les femmes ne peuvent plus être confinées dans les préoccupations domestiques par la force”. Et depuis cette date, l’irrépressible mouvement Féministe désigne le “patriarcat” comme le système qui organise la subordination générale de la femme dans la société bourgeoise.
Je dis que si l’on persiste à établir un lien quelconque entre le patriarcat d’Abraham et le patriarcat dénoncé par les Féministes, on est condamné à ne rien comprendre du tout à ce qui est en jeu, à s’égarer de mille manières, et qu’il est grand temps de trancher cette question.
•••
Pour tenter d’y voir clair, il importe avant tout de prendre du recul. L’histoire passée nous fait connaître deux types d’humanité qui se sont succédés : l’humanité Primitive et l’humanité Civilisée. Il n’y en eut pas d’autre, et ces deux types se sont succédés comme contraires directs l’un de l’autre. Les Primitifs plaçaient la source de toute activité dans la Matière, tandis que les Civilisés la placèrent dans l’Esprit. Et c’est le développement achevé du matérialisme primitif qui, en amenant l’humanité archaïque dans une impasse complète, força au renversement complet du mode de pensée et d’action antérieur, fit basculer l’humanité dans le spiritualisme civilisé.
________
L’humanité primitive, tout comme l’humanité civilisée, connut des phases très diverses, un développement tourmenté et sinueux. Mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt : il y eut d’abord une humanité primitive matérialiste, et ensuite une humanité civilisée spiritualiste.
La position directement inverse de l’humanité Primitive et de l’humanité Civilisée se traduit à tous les niveaux. En voici quelques expressions qui touchent au problème du “patriarcat” que je soulève :
|
Primitifs |
Civilisés |
|
Matière Émanation En Deçà/Ici-bas Ancêtres Fécondité Naturelle Nature/Humanité Totalitarisme Sang-Sol Commun-Personnel Communauté Coopération Parenté Dons Coutume Sexe-Âges Honneur Initiation Sagesse Tradition
|
Esprit Création Ici-bas/Au-Delà Grands Hommes Travail Humain Humanité/Nature Civilisation Marché-Patrie Privé-Public État Division du travail Propriété Valeurs Droit Manuels-Intellectuels Contrat Éducation Raison Foi |
Dans ce schéma, que peut-on faire du “patriarcat” des Hébreux ? Peut-on y insérer le “patriarcat” des Féministes ? Tout est là !
•••
Abraham et ses pareils appartenaient sans doute possible à la société Primitive. Or, ladite société, gouvernée par la Fécondité et la Parenté, s’avère fondamentalement et de part en part une société Maternelle. Si on ne perd pas de vue ce trait essentiel, on peut dire que l’humanité primitive est “matriarcale”.
Mais que deviennent alors nos célèbres Patriarches ? Ils traduisent simplement le fait que la semence masculine contribue à la fécondité générale. Cela ne signifie en aucune façon un renversement de la position de la femme au sens où pourraient l’entendre les Féministes. Tout au contraire même. C’est Sarah qui autorise Abraham à engrosser une servante égyptienne pour que la postérité du clan soit assurée ; c’est elle encore qui oblige Abraham à chasser l’enfant de cette union, bien que ce fût le premier-né, dès lors qu’elle perd sa stérilité. Et je rappelle qu’encore aujourd’hui, on est juif par la mère…
En définitive, le “patriarcat” des Hébreux n’est rien d’autre qu’une variante et une péripétie du Matriarcat primitif. C’en est même un perfectionnement. De plus, le patriarcat des pasteurs nomades n’est qu’un perfectionnement particulier et transitoire de la société maternelle primitive. N’oublions pas que le parachèvement de l’humanité primitive ne se trouve que dans les empires asiates d’Égypte et de Chaldée. Et que voyons-nous, par exemple, à Babylone ? La Puissance femelle Tiamat est dite posséder quatre yeux et quatre oreilles, c’est-à-dire une nature doublement supérieure à celle des autres puissances. Elle est l’abîme d’eau salée d’où sortent toutes les “créatures” ; elle est le fœtus (koubou) cosmique.
Il ne faut pas envisager le matriarcat, au sein de l’histoire primitive, comme une simple phase initiale, celle des “déesses-mères”, très vite remise en question par l’insinuation du patriarcat, lequel serait à partir de ce moment toujours en progrès, et menant insensiblement à la situation civilisée. Au contraire, le matriarcat ne fait que se purifier et se renforcer tout au long de l’histoire primitive, jusqu’à la crise finale, 875 avant J.C. (cf. naissance de l’Arménie). Alors s’impose un retournement complet de situation. Les déesses-mères de “l’âge des cavernes” ne sont que la forme naïve, totalement inconséquente du matriarcat primitif général.
Une autre idée à abandonner est celle de ne voir, sous le matriarcat primitif, les femmes liées à la guerre que sous la forme où l’on voit leur combat personnel comme Amazones. La “déesse” la plus populaire d’Assyrie et de Babylone, Ishtar (Vénus), “Dame du Soleil”, souveraine des dieux et des hommes, patronne et protectrice des dynasties, qui a le privilège de donner le pouvoir au Roi par l’anneau et le sceptre, comment nous la présente-t-on ? On dit : “Sa fête, c’est le combat, et de bondir à l’assaut. Le lot qui fut donné à sa nature, c’est d’être enragée à la bataille”.
En résumé, parler de “patriarcat” au sein de l’humanité primitive, au sens où cela peut être compris par les Féministes, est un contresens total ! Je prends un exemple. En 1150, au beau milieu de l’ordre civilisé, le grand théologien du catholicisme latin, Pierre Lombard, définit le culte d’hyperdulie. Ceci élève la Vierge Marie au rang de “reine du Ciel”, souveraine non seulement des Anges, mais même de tous les Saints, Pierre et Paul y compris. Marie, une femme ! De grandes autorités chrétiennes s’effrayeront alors, disant que “Notre-Dame” se voit conférer des attributs essentiels de “Notre Sire” Jésus. Serait-il sérieux pour autant de considérer que l’humanité civilisée devint alors “Matriarcale” ? Cela serait absurde. Il n’y a que des Régine Pernoud pour entreprendre d’embrouiller les choses à ce point… C’est de la même eau que les vieux discours faisant de la réclame pour les corporations de métiers du moyen-âge, présentées comme la solution au problème de l’esclavage salarié… Dans le sens réactionnaire, la démarche manque d’audace, si on peut dire : car l’esclave antique était encore moins exploité que le serf médiéval. Mais le problème n’est pas là. Est-il sensé d’envisager de nous ramener à une situation passée qui, précisément, a engendré l’état présent auquel il s’agit de faire face ? Organiser cette régression est d’ailleurs tout à fait impossible, ce qui prouve que les projets réels de leurs auteurs sont tout autres que ceux qu’ils affichent. Le vrai secret de l’aggravation effective de l’exploitation de l’homme par l’homme, de l’esclavage au servage, puis au salariat, c’est qu’elle fut en même temps non seulement bénéfique, mais encore souhaitée, impulsée et mise en œuvre par les exploités eux-mêmes. Mais pour comprendre cela, il faut être initié à la “dialectique” !
________
Comment aborder, maintenant, la question du “patriarcat” des Féministes. Ici aussi, il faut prendre garde à ne pas poser maladroitement le problème !
Le premier point, dont il faut absolument se pénétrer, c’est que les femmes se placèrent au premier rang dans le combat prolongé, tortueux et sanglant pour renverser le régime du matriarcat primitif devenu un cauchemar social. De la même manière, les femmes s’engagèrent de manière décisive durant 25 siècles dans l’œuvre du perfectionnement du régime domestique civilisé, y compris jusqu’à l’établissement du Code Civil (1803), qui affirmait la “puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants”. Les pires contre-sens sont étalés de nos jours à ce sujet, à la fois par une ignorance crasse et par une hypocrisie révoltante. En fait, c’est la même chose dans tous les domaines : à propos de la religion, de la science, de l’égalité politique, de la liberté économique, etc.
Le deuxième point, c’est qu’à partir de Mary Wollstonecraft, durant 50 ans (1795-1845), une immense fermentation se développa en faveur de “l’égalité des sexes” et dans le mouvement du Féminisme Utopique de Saint-Simon et Fourier. Ceci fut couronné par l’action de la grande Flora Tristan (1840). Il le fallait bien, puisque le régime domestique civilisé avait maintenant fait son temps, comme c’était arrivé, bien longtemps auparavant, au matriarcat primitif. Le dernier fruit du régime de la “puissance maritale” avait été cueilli par la Révolution française ; il fallait maintenant en tirer les pépins pour en faire la graine d’un nouveau système. Car la grande protestation Féministe de 1795-1845 n’était pas “utopiste” au sens d’irréalisable ; elle venait au contraire à point nommé, et sur le plan théorique, Marx mis à part, rien jusqu’à nos jours ne l’a dépassée. Ce n’est que sur le plan de l’action que le féminisme a accumulé des expériences depuis cette époque : avec les Quarantuitardes (1848), les Communardes (1871), les Suffragettes (1905) et le Women’s Lib. (M.L.F.) en 1970.
Alors, en quoi consiste exactement ce que les féministes, le mouvement spontané des femmes, nomme “patriarcat” ? En quoi cette appellation est-elle “utopiste” ?
L’humanité civilisée rejette toute approche du monde en termes de Fécondité et de Parenté. Ce qui la caractérise, c’est précisément d’opposer à cette conception Primitive la perspective directement inverse, selon le Travail et la Propriété.
La société civilisée pose le Ménage privé comme la “cellule fondamentale” de la société. L’ensemble de ces cellules-propriétaires forment la Population de la Nation. Ceci dit, il y a immédiatement et inévitablement polarisation de ces ménages : les uns sont propriétaires Actifs et les autres sont propriétaires Passifs. Les ménages actifs sont détenteurs des moyens de production, ce qui les fait simultanément entrepreneurs, employeurs. Les ménages passifs sont détenteurs de la force de travail, ce qui les fait employés, personnel d’entreprise simultanément. À leur tour, les propriétaires actifs, “offrant des garanties”, sont investis du privilège de la Citoyenneté Active, soit en tant qu’électeurs, soit en tant qu’éligibles. Il s’agit cette fois de la gestion du Territoire de la Patrie, de tout ce qui concerne la propriété Publique, que la Nation dans son ensemble regarde comme “privée” vis-à-vis des étrangers. Mais cela nous fait sortir de notre sujet.
Que se passe-t-il à l’intérieur des Ménages au sein de la “société domestique” dont l’Union Conjugale donne le départ ?
On dit l’épouse “maîtresse de maison”. Il faut s’entendre. Dans le ménage au sens strict, il n’est question que de Revenus et de Consommation de valeurs, et non point de Production ou Création de valeurs. Il n’y est pas question de moyens de production, mais seulement de force de travail. Précisément, il y a la force de travail Active du Mari, et la force de travail Passive de son Épouse. Il y a donc un malentendu possible quand on parle de la “maîtresse de maison”, la “reine du foyer”.
•••
D’abord, quand j’ai dit que les ménages de l’employeur et des employés relèvent de l’entreprise, il s’agit des revenus procurés par l’activité dans l’entreprise, lesquels doivent subvenir aux besoins respectifs des ménages en question ; quant à l’activité elle-même au sein de l’entreprise, elle ne doit être exercée que par les chefs de ménage, à l’exclusion du conjoint – qui sera dans le cas normal l’épouse – et des enfants à charge. C’est bien pour cela que le ménage est une cellule à part, et la base du système. Il importe cependant de rappeler à nos apologistes de la “famille” que l’entreprise privée occupe effectivement les ménages de façon indirecte, et qu’elle est totalement et exclusivement responsable de la sécurité de leur existence.
Ceci a d’énormes conséquences. D’abord, il y a le fait de l’incorporation d’une partie significative des femmes dans la “population active”, c’est-à-dire hors du ménage et dans l’entreprise, phénomène désormais chronique suite aux guerres mondiales et à l’épidémie des divorces depuis 1945. Le Système se vante de cette situation, ce qui ne s’accorde pas exactement avec son autre discours sur la défense de la famille présentée comme la chose la plus sacrée ! C’est un peu fort de café ! En réalité, la nécessité importante et chronique du travail des deux conjoints pour subvenir aux besoins du ménage est la marque la plus violente de la “paupérisation absolue” des salariés, de la décomposition barbare du ménage privé, de la dégradation du sexe féminin dans son ensemble, et de la dérive générale de la jeunesse. Le travail des femmes, dans les conditions présentes, est incomparablement plus grave que le travail marginal et passager des enfants dans les manufactures en 1840 ! En effet, on voit parallèlement que la prostitution, loin de reculer, est devenue endémique, et se présente sous les nouvelles formes de la prostitution “occasionnelle” de nombre de mères au foyer, tandis que les femmes salariées font l’objet du “harcèlement sexuel” dans l’entreprise ; enfin, que les femmes “cadres” sont celles qui sont le plus loin de la parité des salaires, alors qu’elles forment une couche sociale désormais institutionnelle devant renoncer en fait à toute vie domestique.
Autre conséquence de l’occupation théorique des ménages tout entiers par l’entreprise, au travers de leur “chef” : les “cotisations ouvrières” concernant la “couverture sociale” sont absolument anti-libérales, et la gestion de ces cotisations, dite “paritaire”, en fait bureaucratique et parapublique, est absolument réactionnaire, une monstruosité du capitalisme parasitaire, aux yeux mêmes de la théorie économique libérale qui l’envisage comme une affaire strictement civile.
•••
Revenons à la “maîtresse de maison” de la société civilisée moderne occidentale. Il semble de prime abord que c’est elle qui se voit confier la force de travail Active dans le ménage, puisque c’est elle qui doit accomplir les “tâches ménagères”, ou qui est chargée de s’assurer de leur accomplissement. Or, même dans les “maisons bourgeoises”, où Madame se trouve à la tête d’une équipe de domestiques, et où donc le ménage a tous les dehors d’une mini-entreprise – disons de “services” – , il ne s’agit pas du tout de cela au sens réel, économique, du terme.
• La situation véritable est la suivante : dans tous les cas, comme dit le Code Civil, “le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari”. Or, que veut dire “protéger” la femme ? C’est ramener de l’argent au ménage tout simplement. On dit protection de la femme parce qu’autour d’elle, de ces fonctions qui s’enchaînent : Amante – Mère/Nourrice – Ménagère, se résume l’existence du ménage. Il n’en reste pas moins qu’avant d’exister, il faut être, de sorte que l’apport d’argent du mari conditionne totalement l’existence du ménage. Notez que la protection de la femme, étant assurée par l’apport d’argent pur et simple, ne revêt aucun caractère de classe. L’argent qui “arrive” au ménage, qui fait et soutient son existence, est simplement de la monnaie, du travail général abstrait matérialisé, de la valeur sous sa forme fétiche élémentaire, de la marchandise générale. Ce n’est ni une marchandise proprement dite, comportant une utilité, un bien de consommation; ni du capital-argent, destiné à être “investi”, donnant pouvoir sur du travail productif, capable de rapporter de l’argent lui-même. En assurant l’apport d’argent régulier minimum au ménage, le mari est la personne du ménage qui détient la force de travail Active parce qu’il assure l’accès continu du ménage au marché des biens de consommation nécessaires ou de luxe. Cette distinction entre biens nécessaires et de luxe fait seule la différence entre le ménage d’employeur ou exploiteur, et les ménages d’employés ou exploités. Le mari peut tirer son argent de son salaire d’exécutant ou de son salaire de “direction”, cela ne fait pas de différence. Si l’on s’en tient au point de vue du ménage isolé, il importe peu, d’ailleurs, que l’alimentation du ménage en argent provienne, soit d’un héritage ou du fait de manger son capital ; soit d’un gain à la loterie ou d’un gain d’une activité improductive, parasitaire, immorale ou criminelle. Il reste de tout cela que le mari apporte de l’argent au ménage comme la Providence de ce dernier.
En toutes circonstances, l’argent du ménage ne sort pas de la sphère de la consommation, nécessaire ou de luxe, qui fait du ménage un “client” unilatéral et de l’argent un moyen d’achat de marchandises. Il peut tout d’abord servir à l’élévation de l’aisance matérielle ou faire l’objet d’économies monétaires (Caisse d’Épargne). Ensuite, il peut s’employer à la Bienfaisance ou être converti en “trésor”, c’est-à-dire “valeurs-refuge” (bijouterie, orfèvrerie). Les bornes de l’emploi de l’argent du ménage se trouvent enfin, soit dans la prodigalité (faste), soit dans l’usure (cf. “Ma Tante”, le crédit municipal…).
• Du côté de l’épouse, de la maîtresse de maison, qu’observe-t-on ? À la Providence du mari fait ici écho le Dévouement de la femme. Riche ou pauvre, on ne fait pas de différence de principe. Évidemment, la femme aisée peut se décharger de l’exécution des tâches ménagères sur des employés de maison ; mais le vrai problème est tout autre. Il est que si le mari, par définition, “met les pieds sous la table” en son foyer, son épouse, elle, aussi affairée qu’elle soit à la maison, ne “travaille” pas plus, et même moins encore, au sens économique et historique du terme. Si ménage il y a, d’ailleurs, ce n’est pas pour y travailler, ce qui est la fonction propre de l’entreprise. Là est tout le problème ! D’où justement, toutes les interrogations sans réponse sur le “travail invisible” de la femme, sur la “double journée” des femmes impliquées par ailleurs dans le travail marchand, c’est-à-dire le vrai travail… Comment donc aborder le fait de la dépense d’énergie de la femme consacrée aux “soins du ménage” ? Ce fait tient tout entier à ce que la femme figure dans le ménage comme dotée de force de travail Passive. Cela signifie que tout ce qu’elle peut faire au titre de ménagère ne vaut que comme fonction naturelle, comme conséquence, prolongement, corollaire, appendice, “accident” au sens philosophique, du fait qu’elle est mère et nourrice par destination. Par suite, on ne peut la tenir comme “le prolétaire de l’homme”, ni comme “serve” ou “esclave” relativement aux occupations qu’elle assume, mais comme déployant du pur “travail concret” comme dirait Marx ; comme exerçant un attribut de la fécondité, exactement sous l’angle où l’humanité Primitive envisageait l’activité humaine. La seule différence, c’est que ce type d’activité, dans l’humanité civilisée, ne se trouve que dans le ménage, ne donne lieu à aucune production concrète, mais seulement à des services concrets. Le travail de la femme ne fait l’objet, à l’égard de son mari, ni d’un commerce, ni d’une exploitation ; il est fait de dons spiritualisés, qui sont le complément de la valeur matérialisée sous forme d’argent qu’apporte le mari.
Le Ménage civilisé (moderne achevé), qui est la chose la plus commune, est en même temps la plus étrange qui soit. Et il ne faut pas longtemps pour voir le néant du vieux lieu-commun selon lequel “l’État n’est que la réunion des ménages”. Les produits de l’entreprise, en tant que marchandises, se présentent comme l’unité hégémonique de la Valeur et de l’Utilité. Les fruits de l’union conjugale, du Ménage, se présentent tout autrement : comme l’union de la Grâce spirituelle venant du Mari, et des Bénédictions matérielles venant de l’Épouse (En hébreu, “bénir”, déverser sa faveur, qui se dit “bârak”, signifie également “s’agenouiller”).
•••
Il ne peut en être autrement, puisque, par le côté du ménage, l’Humanité civilisée, qui se propose de régner sur la Nature, rencontre le problème de sa subordination à cette Nature même en terme de Population. On ne trouve l’équivalent de ce défi naturel qu’au pôle opposé de la société civilisée : à propos de la Patrie. Ici se pose le problème complémentaire à celui de la Population, celui du Territoire. Sa face “spirituelle” est celle de la Stratégie, de la Puissance Militaire du pays ; sa face matérielle est celle de la Géopolitique, du contrôle des Réserves de Matières Premières du monde (avec ce que cela implique : lignes de communications, points d’appui stratégiques). Concernant cette affaire, on voit s’étaler la vanité de tous les bavardages sur les “frontières naturelles”; de même que vis-à-vis du numéraire rapporté par le mari et fondant l’existence du Ménage, on a eu les débats sans issue sur les métaux dits “précieux” par nature.
Ce n’est pas seulement dans ses pôles du Ménage et de la Patrie que la société civilisée, celle de l’homme maître de la Nature, du Travail et de la Valeur, voit la Matière rappeler à l’ordre l’Esprit. Dans son corps même, dans l’action du Capital et de l’Industrie, dans l’existence de l’Entreprise et la Nation, la Nature pénètre de toute part et grève l’économie marchande de façon insoluble. Ceci ne se manifeste pas seulement de façon ultime, dans les Crises de surproduction d’hommes et de produits, où l’Utilité se rebelle contre la valeur, en lesquelles tous les aspects du problème se rassemblent en un seul nœud. C’est, en accompagnement du travail productif (créateur de valeur et survaleur), le problème global du Tribut Foncier. À la base, il y a l’antagonisme Ville-Campagne, l’exode rural et les catastrophes “naturelles” consécutives. Ensuite, en Ville même, c’est le problème de l’Immobilier, avec d’un côté les Centres d’Affaire (Triangle d’Or) et de l’autre les Z.U.P. ou cités-dortoirs. Suite à cela, on peut découvrir que la pollution, les transports et la disparition de l’exercice physique posent le seul vrai problème fondamental de la Santé publique et de la Sécurité Sociale…
Au total, le problème aigu de la relation Nature-Humanité, ce qu’on appelle l’Écologie, prend sa vraie dimension si on reconnaît qu’elle englobe les aspects Natalité-Foncier-Étrangers. Ceci fait le vrai terrain de la question du Ménage et de la Femme. Ce n’est évidemment pas ainsi que voient la chose les viragos du genre Françoise Giroud et Yvette Roudy...
L’Écologie, c’est : Démographie – Ressources Naturelles – Géographie.
Ainsi, la question de la P.A.C. (politique agricole commune), des “montants compensatoires”, est aussi au cœur de l’écologie. C’est rien moins que le fait que les Matières Premières (agricoles, minières, énergétiques) se comportent à l’envers des lois classiques de l’économie politique : une récolte inespérée, par exemple pour des raisons climatiques, est une calamité qui fait s’effondrer les cours. De même le fameux phénomène des “rendements décroissants” (Ricardo), que l’économie rencontre avec la fécondité naturelle, et que les malthusiens s’empressèrent d’opposer au travail humain.
•••
Si on lie l’idée de “patriarcat” à celle de Père, et l’idée de père à la fonction biologique posée comme primordiale du spermatozoïde relativement à l’ovule dans la conception des enfants, comprenant de cette façon le renversement du matriarcat primitif, on s’égare totalement.
Le ménage civilisé naît avec le mariage, et le mariage est un Contrat. C’est ce qu’il ne faut perdre de vue à aucun moment. Le ménage, cellule privée, est un être juridique. Le ménage, bien évidemment, prend appui sur une nécessité naturelle, puisque c’est le lieu où s’effectue la procréation ! Mais, précisément, la procréation dans le cadre du ménage a pour but de se donner des héritiers, support de la richesse entendue comme Valeur, et non plus une Postérité, occasion de la richesse entendue comme Don. C’est bien pour cela que dans l’antiquité les citoyens pauvres “exposaient” leurs enfants. Bien sûr qu’on ne peut avoir d’héritiers “sans” faire des enfants ! Mais cela ne doit pas nous égarer. L’humanité civilisée voit en cela une contrainte consécutive aux conditions charnelles d’ici-bas, une obligation inhérente à la vie “dans le siècle” et que nous avons justement à surmonter.
La caractéristique du ménage civilisé, c’est qu’il rejette la vieille perspective de la procréation, selon la matière et la nature, selon la fécondité et la parenté ; c’est au contraire selon l’esprit et l’humanité, selon le travail et la propriété qu’elle est désormais envisagée. Cela ne veut pas dire du tout que le spiritualisme civilisé nie que les humains de ce monde ont un corps ! ni qu’ils ignorent qu’il faille des parents pour que les enfants voient le jour ! Les théoriciens du ménage distinguent la procréation et la sexualité ; la sexualité qui n’est pas spiritualisée est “concupiscence”, diabolique, étant donné que le corps n’est tolérable que comme le “temple de l’âme”. Tout cela est très clair, et seul l’obscurantisme intégral actuel fait qu’on embrouille toutes choses.
Chez les Primitifs, il y avait une Mère fondamentale du monde, telle Cybèle, “La Dame” ; et de cette Mère s’auto-fécondant, émanait le monde. Chez les Civilisés, il y a un Père du monde, qui s’avoue lui-même niant et relayant la Mère, preuve en est que Zeus est dit fils de Cybèle-Rhéa. Zeus, créateur des dieux et des hommes, Démiurge (“ouvrier” Suprême), a pour première épouse Métis, fille de l’Abîme liquide. Métis enceinte, Zeus craint que l’enfant ne soit plus sage et puissant que lui-même ; il avale la mère au premier mois de la grossesse, et c’est de la tête de Zeus (non pas de la matrice maternelle) que sort Athéna, qui institue l’Aréopage d’Athènes, préside donc à la Cité civilisée. On voit ici le retournement du matérialisme primitif en spiritualisme civilisé. Alors que Cybèle était la source de toute conception matérielle et physique, de fécondité manifeste, Zeus “conçoit”, au sens spirituel et moral, du travail manifeste. L’inversion de sens du verbe “concevoir” est caractéristique.
•••
Le Ménage est la cellule privée élémentaire de la société civilisée, il est créé juridiquement par le Contrat d’union conjugale ; quoique prenant en compte la matière, la nature, le corps et la fécondité féminine, ce n’est plus à la Race humaine des primitifs qu’il donne le jour, mais au Genre humain civilisé. On ne peut trop insister sur cette spiritualisation du “sang” qu’inaugure la civilisation.
Le Ménage est la cellule élémentaire, cela signifie que cette cellule constitue l’unité substantielle ultime ici-bas pour l’humanité civilisée. Tous les discours sur le “respect de la personne humaine” ne doivent pas masquer ce fait. Les Personnes qui appartiennent au Ménage ne sont que des “rôles” qui développent le Ménage privé, des fonctions de celui-ci, qui n’existent que par lui et pour lui. Que l’on s’en prenne ou non au mâle, au Père, aux “privilèges” du Mari même, cela n’ôte pas le fait que le “sexe fort” est prisonnier du ménage, dans l’exacte mesure où le “sexe faible” y trouve un asile, le lieu hors duquel la femme s’offre en proie au marché du sexe.
Le Ménage a pour base le couple des personnes physiques du Mari et de l’Épouse. Les deux se “complètent”, comme on dit, mais de façon totalement unilatérale. Le mari y figure comme source de travail abstrait cristallisé, apporteur d’argent, qu’il tire normalement de son appartenance à la “population active”, de sa liaison à une Entreprise. D’ailleurs, l’épouse, en cas de décès de son conjoint, n’a droit qu’à une pension “de réversion” qui a la même origine. L’Épouse, elle, figure dans le ménage comme source de travail concret, de force de travail vivante mais passive, prodiguant des dons qui sont adventices de celui de la maternité ; toute l’activité qu’elle peut déployer est du type que connaissait l’humanité primitive, diamétralement opposée à ce qu’on nomme “travail” dans la civilisation. Le ménage n’est pas une Entreprise ! Ce n’est pas l’intérêt qui le gouverne, et les “mariages de raison” subissent la réprobation de l’opinion. C’est de sentiments “jaloux” que la femme mérite d’être “payée” par son mari.
Le Ménage ne peut se réduire à l’union hégémonique physique Mari-Femme, insuffisant pour former la cellule privée substantielle. Ce qui surmonte la relation unilatérale, c’est la présence d’une troisième “personne”, Morale celle-là : celle du Chef de famille, l’Homme, qu’on doit prendre garde à ne pas identifier sommairement au Mari. Les personnes physiques “passent” ici-bas ; la personne morale se perpétue par le “nom de famille” que transmet son chef. C’est en tant qu’Homme que le Mari contracte pour le Ménage, aliène, plaide et se fait valoir comme citoyen (actif ou passif). C’est en tant qu’Homme que le Mari a “droit” à l’obéissance de la femme (y compris pour le “devoir conjugal” de celle-ci) et droit de “correction” sur les enfants, mais aussi devoir de maîtriser et blâmer la personne physique qu’il est comme simple Mari, sous le contrôle des proches, devant l’opinion publique et, en dernier ressort face à l’autorité politique qui légalise sa personnalité morale, c’est-à-dire sa capacité d’accomplir les actes de la vie civile.
Il faut noter encore que, pour des raisons empiriques, le chef de famille se trouve confondu pratiquement avec la personne du Mari ; cependant, comme toute règle civilisée, elle comporte des exceptions. La personne morale est masculine par incidence, mais comme telle elle n’est sexuée que théoriquement. En outre, si le mari est réduit au rôle d’apporteur d’argent, l’argent abstrait de son origine n’a pas de sexe. Ainsi, il peut se faire que, par dérogation, le chef de famille soit l’épouse, de même que le chef de l’État peut être une reine…
N’oublions pas, enfin, que le régime domestique civilisé est tellement anti-racial, rebelle au critère primitif de la Fécondité, que la loi interdit constamment la “recherche de paternité” : “l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari”. Ce n’est qu’en 1970 (!), entre autres gadgets, dans la foulée du suffrage féminin et de l’I.V.G. (avortement), qu’on offrit à la femme mariée (!) la possibilité de contester la paternité du mari. Notre époque de Barbarie Intégrale aiguë croule sous la montagne des “acquis sociaux” à en crever !
•••
Il y a un point très simple à ne pas perdre de vue pour éviter de s’égarer : pour l’humanité civilisée, une personne est union de l’âme et du corps, et l’âme est le vrai Moi ; or l’âme ne vient d’aucune façon des parents, mais est création spéciale de Dieu. Ceci suffit à éliminer tous les contresens à propos du “patriarcat” civilisé. Il est utile pourtant d’examiner cela de plus près.
Ce qui fait l’homme, l’être humain, de manière distinctive, c’est son âme, la substance spirituelle. La première chose est donc d’écarter la matière, la fécondité, la nature, la parenté charnelle. L’âme n’est pas naturelle, mais directement surnaturelle. C’est ce qu’on entend quand on dit l’homme créé “à l’image et la ressemblance” de Dieu, Esprit Absolu. Qu’est-ce qui peut entraîner la confusion à partir de là ? Premièrement le fait que l’esprit est déclaré “substance”, ce qui peut masquer l’abîme séparant la vie et la pensée dans la mentalité spiritualiste pure. Deuxièmement, il est vrai que l’Esprit, Dieu, implique une idée “masculine”, mais ce caractère n’est imprimé à l’esprit, à l’âme, que comme une dérivation du rôle prééminent donné par la civilisation au Travail, à la Raison et à la Propriété. Évidemment, dans le ménage privé, à l’homme qui doit “gagner son pain à la sueur de son front”, correspond la femme qui doit “enfanter dans la douleur” ; la “douleur” en question devant être prise au sens de la “dépendance” qu’occasionne la maternité, productrice d’“héritiers”.
Si on examine à présent, le fait que les personnes, ici-bas, sont l’union nécessaire d’une âme et d’un corps de chair et de sang, que peut-on dire de ce côté matériel, naturel, entièrement subordonné ? D’abord d’une manière générale, la matière et la nature relèvent du Créateur, de l’Esprit Absolu, vis-à-vis duquel elles sont pur Néant, et qu’il tire pour cela “du néant” (ex-nihilo). L’origine spirituelle de la matière et des corps, des choses et des objets ne peut qu’apparaître également. Elle apparaît en ce sens que la nature, les choses et les corps sont sensibles-intelligibles, qu’ils sont pour nous non-être simplement – et non point néant ou chaos – mais marqués d’esprit divin manifeste à titre passif, de mouvement “acquis” ou mécanique, moyen et instrument de l’esprit actif, spontané ou dynamique dont l’humanité a le privilège. Bref, le corps de l’homme et de la femme sont aussi de-Dieu, bien qu’indirectement, à la différence de l’âme. C’est seulement pour ce corps que les parents interviennent immédiatement dans la génération. Ici, le rôle du mâle peut bien l’emporter sur celui de la femelle, mais on ne doit en juger que sous réserve du fait que la matière, en dernière analyse, est de-Dieu, de l’Esprit comme tout ce qui appartient à la Création ; et sous la réserve du fait que le corps est simple accessoire nécessaire de l’âme. Tous les êtres matériels, naturels, corporels, sont le fruit de l’action conjuguée du Feu solaire et de l’Eau terrestre, disait Thomas d’Aquin ; dans le cas du corps humain, le père tient lieu de l’action astrale, apporte la forme particulière du corps de l’enfant, par sa semence ; la mère contribue à la génération en prêtant sa vertu terrestre, déterminant dans l’enfant la reproduction de l’espèce humaine. Il est clair que cette répartition des rôles masculin et féminin dans la génération charnelle est cohérente avec la prévalence du mari sur l’épouse consécutive à la domination de l’esprit et du travail dans la société civilisée ; mais il est tout autant clair que ce côté corporel n’en est qu’une conséquence très éloignée. De toute façon, la position directrice du mari sur l’épouse n’a absolument rien à voir avec une question de force musculaire comme le veut l’opinion vulgaire. Tout au contraire ! Elle vient de ce que le mari se trouve pratiquement être le détenteur de la force de travail active, fontaine de “valeur”, dans le ménage privé, qu’il est à ce titre le “protecteur” de la cellule domestique, et qu’il attend en retour que ses garçons soient le soutien de sa vieillesse par une activité du même ordre, par les “services de la piété filiale”, “fruits de la vertu et non pas de l’instinct de la nature”. Or, si l’union conjugale se trouve être l’union de la “puissance” du mari et de la “tendresse” de l’épouse, par le fait du travail et de la propriété, ceci a une origine spirituelle. Mari et épouse portent une même chaîne, sont sous le même joug, celui du ménage privé ; mais la maternité développée dans ce cadre impose une relation hégémonique, unilatérale. Prenons l’exemple chrétien. “L’homme n’a point été tiré de la femme, mais la femme de l’homme” (I Cor. XI-8). “Jésus-Christ est le chef de l’homme ; de même l’homme est le chef de la femme” (I Cor. XI-3). Aristote dit : “L’intellect vient du dehors”. Cela signifie que l’esprit, l’âme, dominant le corps, ce fait primordial qui autorise la domination du travail sur la fécondité, subordonne spirituellement la femme à l’homme, mais au moins autant l’homme à Dieu.
•••
Il y eut l’humanité Primitive, puis l’humanité Civilisée. Ces deux sociétés sont directement inverses, comme la mentalité Matérialiste primitive et la mentalité Spiritualiste civilisée. La transition d’une humanité à l’autre fut marquée par une crise effroyable de la société archaïque qui dura 250 ans, de 875 av. J.C. à 625 av. J.C., c’est-à-dire de l’Assyrien Assour-nâtsirapli II au grec Hésiode. Ce fut une crise véritablement universelle, dont on ne trouve aucun équivalent jusqu’à la crise universelle que connaît notre époque, l’époque Contemporaine initiée en 1845, qui est la crise de toute la Préhistoire humaine, englobant l’humanité civilisée avec l’humanité primitive. Notre temps est celui de la domination de la Barbarie Intégrale, celui du choix entre le Communisme Civilisé et le pur et simple suicide de l’humanité.
Quand une issue fut trouvée à la crise du Communisme Primitif, il y a 2500 ans, on n’eut d’abord qu’un minuscule îlot hellène, entre Thèbes, Corinthe et Athènes, et la Cité grecque nous apparaît elle-même avec bien des dehors primitifs ! Mais le grand livre de la Civilisation se trouvait ouvert ! Ce ne fut pas une mince affaire d’en couvrir les pages ! Le fait décisif, dans la question qui m’occupe, celle du régime domestique et de la condition des sexes, est qu’on avait résolument répudié le Matriarcat primitif pour s’engager sur le terrain du Ménage privé, de l’Union Conjugale.
On aura noté que pour traiter du Ménage civilisé, j’ai pris soin de prendre celui-ci sous sa forme typique et pure, c’est-à-dire tel qu’on le trouve seulement à l’apogée de la société civilisée, dans les Temps Modernes (après 1475). C’est même au sommet des Temps Modernes, à la période finale de 85 ans (1760-1845) que je me suis accroché. Cette période couvre les Lumières, les révolutions américaine et française, et le Socialisme Utopique. C’est alors en effet que s’achève la différenciation du Ménage et de l’Entreprise, qu’on officialise même le fait, et qu’on cherche déjà à dépasser cet état. En un mot, c’est seulement à ce moment qu’on a les moyens d’y voir clair, et qu’on se trouve simultanément obligé d’examiner sérieusement la nature du Ménage et le statut de la Femme.
Les Primitifs, matérialistes, avaient naturellement un régime Matriarcal tout au long de leur histoire ; je pense avoir établi ce fait et en quel sens il faut comprendre la notion de Matriarcat. Je pense avoir démontré également que les Civilisés, spiritualistes, ne peuvent être vus comme ayant établi un régime Patriarcal, sans que le mot n’entraîne les pires errements. Comme il n’est question, sous la civilisation, que de la “puissance maritale”, je préfère de beaucoup parler de régime Marital. Bachofen avait écrit en 1856 “Vom Weiberrecht”, “Du droit Féminin”; plus tard, en 1861, il modifia l’expression, et publia “Das Mutterrecht”, “Le droit Maternel”, ou Matriarcat. Je pense que caractériser le régime civilisé en opposant simplement le Père à la Mère, en parlant de Patriarcat ou “droit Paternel”, est une mauvaise solution, et nous oblige à notre tour à modifier l’expression première. Nous avons donc :
• Primitifs : Matriarcat – parental ;
• Civilisés : Maritalat – contractuel.
________
La question qui se pose à présent est la suivante : aujourd’hui, que dire du Ménage et de la Femme ? Ici, il y a deux choses à considérer :
1- Depuis 150 ans (1845), avec la civilisation en général, le système marital et le Ménage privé qui l’accompagne sont en proie à une crise intégrale, qui ne fait que s’aiguiser et s’approfondir. Ceci est l’aspect fondamental ou stratégique du problème. Il a plusieurs conséquences générales immédiates :
• D’abord, le système marital se trouve, théoriquement et historiquement, dépassé irréversiblement. On ne reviendra pas en arrière, qu’on le veuille ou non.
• Ensuite, avec la crise finale du Ménage civilisé, c’est toute la préhistoire domestique qui se trouve mise en question, le Matriarcat primitif avec le Maritalat civilisé. D’un côté, le Matriarcat primitif y trouve l’occasion d’être redécouvert, enfin compris, et relativement réhabilité. De l’autre côté, il apparaît en même temps que Matriarcat et Maritalat, quoique contraires directs l’un de l’autre, comme le sont matière et esprit, fécondité et travail, parenté et propriété, sont aussi absolument identiques par leur perspective également unilatérale.
• Enfin, face à la crise finale du Ménage privé, toute attitude dogmatique, intellectualiste et moraliste, c’est-à-dire relevant de la mentalité spiritualiste propre à la civilisation, est nécessairement impuissante et illusoire par elle-même. Et cela vaut tout autant pour une apologie formelle du Maritalat que pour sa “condamnation” formelle. Sur ce point précis, Droite et Gauche, Anarchie et Dictature, Utopisme et Barbarie sont logés à la même enseigne, comme Volontarisme et Fatalisme. Moins que toute autre chose, le Ménage privé ne peut voir son sort décidé par décret. Et pour cause : non seulement le Ménage est solidaire de tous les rapports sociaux, mais il met encore en cause directement la relation Humanité-Nature ; et en lui se concentre enfin la question des Mœurs. Avec la question du Ménage privé et du Maritalat, c’est donc celle de la refonte de l’humanité elle-même qui se trouve posée ; ce problème ne peut évidemment être le fait que d’un processus réel, lequel à son tour ne peut être envisagé que de façon pratique, lucide et critique.
•••
2- Depuis 150 ans de crise finale du Maritalat, deux processus diamétralement opposés se développent parallèlement pour y faire face. Il s’agit évidemment de deux manières absolument hostiles de prendre en compte et d’associer les régimes domestiques historiquement révolus de l’humanité, le Maritalat et le Matriarcat. Ces deux manières de traiter le passé et de ménager l’avenir sont celle de la Barbarie Intégrale et celle du Communisme Civilisé. L’enjeu de ces deux Voies n’est rien moins que la direction du mouvement populaire spontané, qui n’est ni lucide ni critique face à la crise finale du Ménage privé.
• La voie de la Barbarie Intégrale est dominante depuis 150 ans. Elle a pour elle tout le poids de la Préhistoire humaine, qu’elle exploite au moyen de l’Argent et des Armes. Il s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en négociant et développant la décomposition du Maritalat, ce qui s’accompagne inévitablement d’une association au Maritalat malade, d’expressions perverses du Matriarcat. Cela nous donne, en lieu et place du Maritalat civilisé, le régime dominant que nous connaissons, lequel ne peut être mieux nommé que celui de la Bestialité. La Bestialité dominante maintient de force l’écorce du Ménage privé, ce qui le fait sécréter un fruit empoisonné, le transforme toujours plus en une union d’un demi-démon mâle et d’un demi-animal femelle. Sur le plan personnel, le couple fondateur du Ménage civilisé était la conjugaison du désir Sexuel du mari et de l’abandon Sentimental de l’épouse. C’est ce qu’on appelait l’“Amour”. Cette relation n’était réciproque que sous l’hégémonie de l’attitude masculine. Cette démarche, fondamentalement “intéressée” des deux côtés, était disciplinée par l’intérêt supérieur de la Cellule domestique, que justifiait tout l’environnement historique et social. Sous le règne présent du Bestialisme, dans le cadre de la putréfaction organisée du Ménage privé, c’est tout autre chose : une affaire porno-mélo. Notons qu’en 1800 on avait en France 6 divorces pour 100 mariages, contre un pour trois à présent... C’est cette voie de la Bestialité qui nous est vantée par les autorités, par les chantres du système dominant. Tirant prétexte qu’on ne reviendra pas au Maritalat civilisé, eux et leurs dupes nous assomment avec les prétendues “conquêtes des droits de la femme” : le suffrage féminin, l’accès à l’emploi, l’avortement libre et l’émancipation érotique. Tout comme le vrai gagnant de la “régularisation des sans-papiers” à la sauce Barbare est le lobby de la Française des Jeux, de même, le vrai gagnant de l’“émancipation de la femme” à la sauce Bestialité, c’est le lobby des Sex-shops. Société Obscène et Proxénète, voilà ce que gèrent les femmes à barbe du Secrétariat d’État créé à cet effet, Haute Instance chargée de la protection des races de gros porcs et petites dindes.
• La voie du Communisme Civilisé est dominée depuis 150 ans, n’ayant pour elle que l’avènement, hors des sentiers battus, de l’Histoire humaine, qui n’a à son service que l’Intelligence et le Nombre… Il s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en organisant le dépassement du Maritalat. Le dépassement du Maritalat, lui, doit être une authentique “double négation” des régimes domestiques primitif et civilisé. On peut nommer le régime domestique de l’avenir un Matriarcat Marital. Cela signifie : que l’apport historique des deux régimes du passé est conservé ; que leur côté unilatéral commun est aboli pour faire place à un vrai rapport ; que le Naturalisme primitif, que répudia l’Humanisme civilisé, retrouve sa place dans le rapport Réel instauré dans la nouvelle Union Sexuelle. Je précise ce qu’implique le nécessaire néo-Matriarcat à fonder et édifier :
- Le ménage privé, la fameuse “cellule” est à abolir évidemment, puisque c’était le cadre du Maritalat notoirement révolu. Je signale qu’on met à présent en vente en Nouvelle Zélande, des appartements… sans cuisine, cet accessoire étant considéré comme inutile dans un ménage “moderne”… Cependant, il est illusoire de vouloir faire “dépérir” le Ménage privé sans s’attaquer à l’Entreprise. Sous la civilisation, l’Entreprise dominait les Ménages, la “personne morale” de la première étant supérieure aux personnes “physiques” des seconds. Le salut des Ménages ne va pas sans leur mainmise sur l’Entreprise.
- L’abolition du Maritalat, par l’extinction organisée des Ménages est vraiment la seule notion saine qui peut animer le mouvement Féministe. Et pourtant, plus encore que de conquête de vrais “droits” de la Femme, c’est du Salut des Enfants et des Vieux qu’il s’agit, eux dont la masse est absolument sans défense sous le Bestialisme actuellement dominant, et alors que les deux sexes se trouvent confondus dans ces catégories…
- Le Ménage privé aboli, les Personnes qu’il comprenait et dans les limites étriquées où elles pouvaient exister, se trouvent conquérir le vrai “respect” qu’on affichait pour elles seulement théoriquement auparavant. Ainsi, l’Union Sexuelle qui prend la place de l’ancienne union conjugale, délivrée des considérations économiques, patrimoniales, émancipée de la maternité privée, fait enfin primer le sentiment sur le désir, donne une réalité tout à fait ordinaire au mot Amour. Le Proxénétisme, jusqu’à présent “intouchable”, peut enfin être vu raisonnablement comme déracinable.
Voici comment, au total, se présente le tableau des régimes domestiques successifs de l’humanité :
1. Matriarcat – Primitifs
2. Maritalat – Civilisés
......... Bestialisme
3. Personnalisme – Communistes
•••
Un fait peut sembler paradoxal, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce qu’on appelle la “dialectique” marxiste : c’est que l’Église que nous avons à bâtir a deux raisons de se lancer dans la défense forcenée de ce qu’il reste du Ménage privé et du Maritalat civilisé.
1- La première raison est un impératif immédiat : le combat contre le Bestialisme dominant. Il n’y a pas le choix. Deux exemples :
Dans les pays dits “riches” du Nord, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” pour la défense des salaires, ce qui est inséparable de la destruction des syndicats jaunes dits “représentatifs”. Une telle perspective d’amélioration du salariat peut paraître conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même salariat dont nous annonçons la nécessaire abolition. Mais ce n’est pas le cas. Dans son combat prenant en charge la défense effective des salaires, la classe salariée ne peut qu’apporter la preuve que l’oligarchie financière au pouvoir est l’agent même déchaîné... contre l’éternisation du salariat ! et le salariat constitué en classe se fait son propre instituteur, acquiert l’aptitude à exercer sa domination politique en vue de l’établissement du travail libre et associé.
Dans les pays dits “retardés” du Sud, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” pour la défense de l’indépendance politique, ce qui est inséparable de la destruction des gouvernements fantoches. Une telle perspective d’amélioration du nationalisme peut paraître conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même patriotisme que l’Internationale annonçait comme préhistorique. Mais ce n’est pas le cas. C’est le combat acharné même pour l’Indépendance nationale qui enfantera la Nation humaine, le renversement de toutes les frontières, la liquidation des hordes de prétoriens et autres “casques bleus” semant le carnage sur la planète.
Il en va exactement de même pour le sujet qui m’occupe. Il y a une guerre à mener pour la défense de la “sainte famille”, c’est-à-dire le Ménage privé. Les militantes exécrées par le système de la Bestialité dominante, celles qui se dressent pour la cause de l’intégrité féminine en arborant le “foulard islamique”, se trouvent aujourd’hui au premier rang de ce combat pour le triomphe de la Pudeur. Même si elles n’en ont pas conscience, ce sont elles qui acheminent réellement le genre humain dans la voie du Personnalisme, vers l’état social d’innocence où tomberont tous les voiles, vers l’état social “naturiste” qui sera la grande revanche d’Adam et Ève du Jardin d’Éden. Que la honte donc s’abatte sur les prétendues “femmes libérées” et les cinglées suicidaires du sex-appeal “torride” !
2- La seconde raison qui lie notre Église-Parti au Ménage privé et au Maritalat est la suivante : qu’il y ait ou non le Bestialisme dominant à notre époque, une fois celui-ci matériellement renversé, subjugué et neutralisé, c’est alors seulement que commence le processus prolongé de “dépassement” pratique du vieil ordre préhistorique Marital-Matriarcal. L’horizon concret de notre Église-Parti ne va pas au-delà de cette ère historique que Marx appela la “période de transition” au communisme civilisé développé, ou encore “phase inférieure” de ce même régime que sera le Personnalisme sur le plan domestique. Cette longue et complexe transition sera nécessairement celle du Non-Ménage, du “droit bourgeois” dans le domaine domestique, et non pas encore réellement le Personnalisme s’épanouissant sur ses propres bases.
Cette question de la Transition n’est pas propre à la question du Ménage, évidemment ; il en va au contraire de même dans tous les domaines. Le dépérissement de l’État et des Armes passe par un nécessaire Gouvernement mondial. Le dépérissement du Marché et de l’Argent passe par la nécessaire Gratuité du seul salaire (de ce qui correspond aux simples besoins de survie). De même encore, l’épanouissement de la Mentalité Réaliste, matérialiste-spiritualiste, passe par l’association intime et stratégique de Marx et Kant ; dans l’horizon concret du communisme civilisé qui nous est imposé, la Réalité marxiste est absolument solidaire de Dieu civilisé et incompréhensible hors de cette association.
Freddy Malot – mars 1999
________
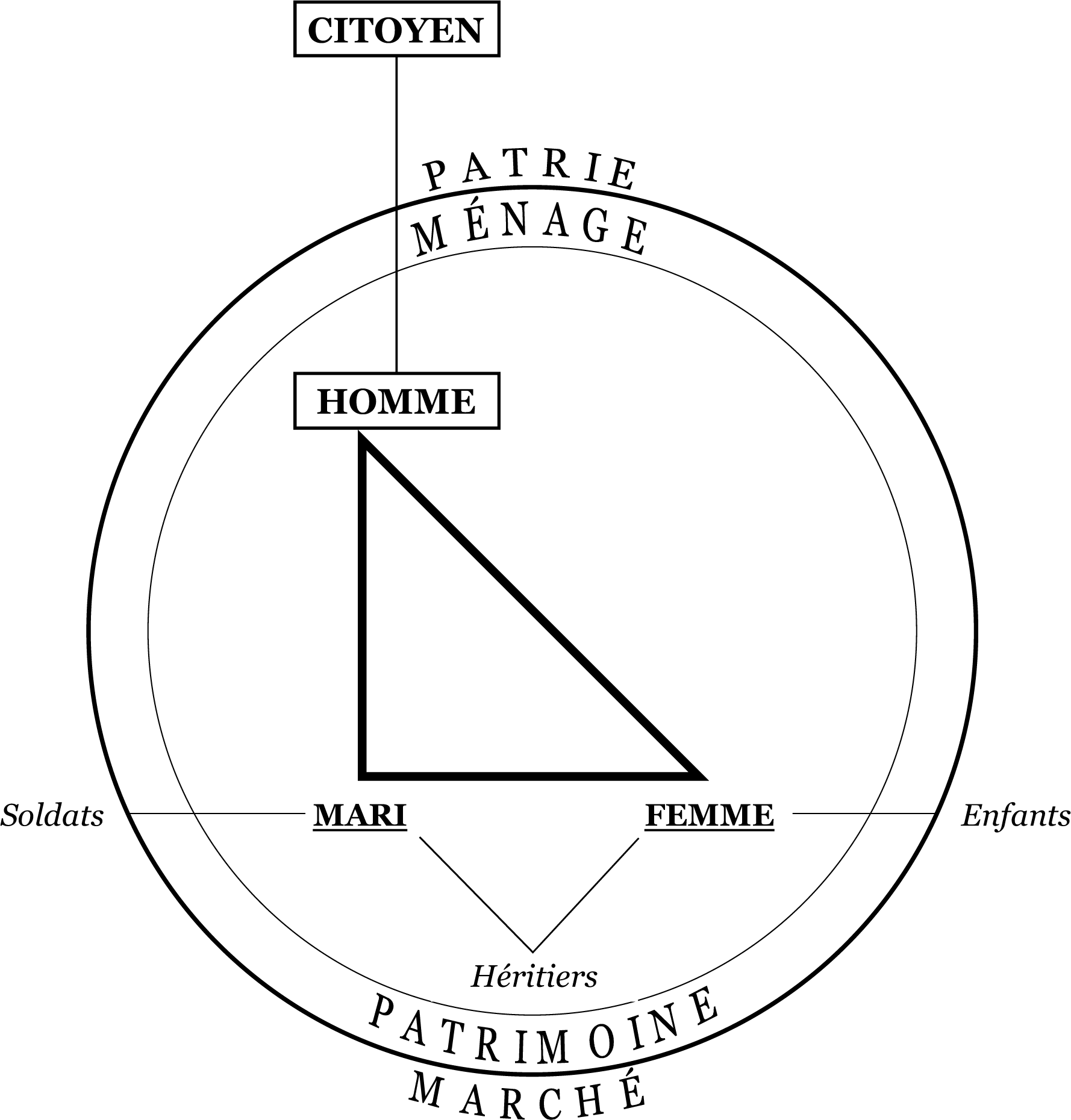
Le ménage privé, sous sa forme pure et simple, tel que le présente la civilisation Moderne, fut défini par le Code Civil (1803) :
À la base, de façon physique et essentielle, il y a le couple Mari et Femme, uni par consentement.
Le couple des époux est ordonné de sorte que : “Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.”
Ceci dit, les époux “se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance”. Le mariage n’a pas pour but le sexe, qui n’est qu’un moyen. Aussi, la “fidélité” mutuelle exigée doit assurer avant tout la légitimité des enfants. Par suite, “l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari” ; “la recherche de paternité est interdite”.
Les Héritiers, ou enfants légitimes réservataires, sont l’accident physique habituel du mariage. Leur rôle est avant tout de perpétuer le ménage, avec le nom du mari ; à ce titre, ils se limitent aux garçons. En tout état de cause, il y a immédiatement “Puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants”.
C’est le mari même, qui porte donc une “double casquette”. Mais tandis que comme mari il est simplement la personne physique principale du couple des époux, comme Homme il est la personne morale du ménage. Comme personne morale autonome et exclusive, l’Homme est l’extrême opposé des enfants, et des filles en particulier, pur accident physique du mariage.
L’Homme, personne morale du ménage, surmonte l’antagonisme mari-femme spirituellement, c’est-à-dire représente le ménage dans son ensemble quant aux contrats et obligations civiles. C’est par lui qu’agit le ménage en tant que Propriétaire, dans ses rapports avec les autres ménages.
Le chef d’Entreprise, désigné comme commerçant par le Code, est lui aussi simple Homme, chef de ménage simultanément, ne serait-ce que par son patrimoine personnel (s’il n’est pas marié) et par sa parenté. Mais l’Homme qui est salarié, “mercenaire”, n’est personne morale qu’à l’égard de son propre ménage ; comme employé, il n’est que membre physique de l’entreprise.
Au total, les Hommes simples, uniquement chefs de ménage, et les chefs d’Entreprise forment l’ensemble de la société civile, les personnes constituant la Famille socialisée moderne, les éléments actifs de ce qu’on nomme le Marché national.
Tel est donc le Ménage privé pur, la Cellule civile fondamentale de la civilisation moderne. Ce ménage pris dans son ensemble est le type de “l’unité antagonique” sociale. C’est pour cela qu’il apparaît “trine” : Mari - Femme / Homme.
Hors de la sphère civile, dans le domaine politique, c’est évidemment l’Homme du ménage qui figurera comme Citoyen de la nation. Et comme le mari peut être appelé à se muer en soldat de la Patrie morale, la femme est conviée à fournir des enfants qui peupleront le Territoire physique de l’État.
Freddy Malot
________
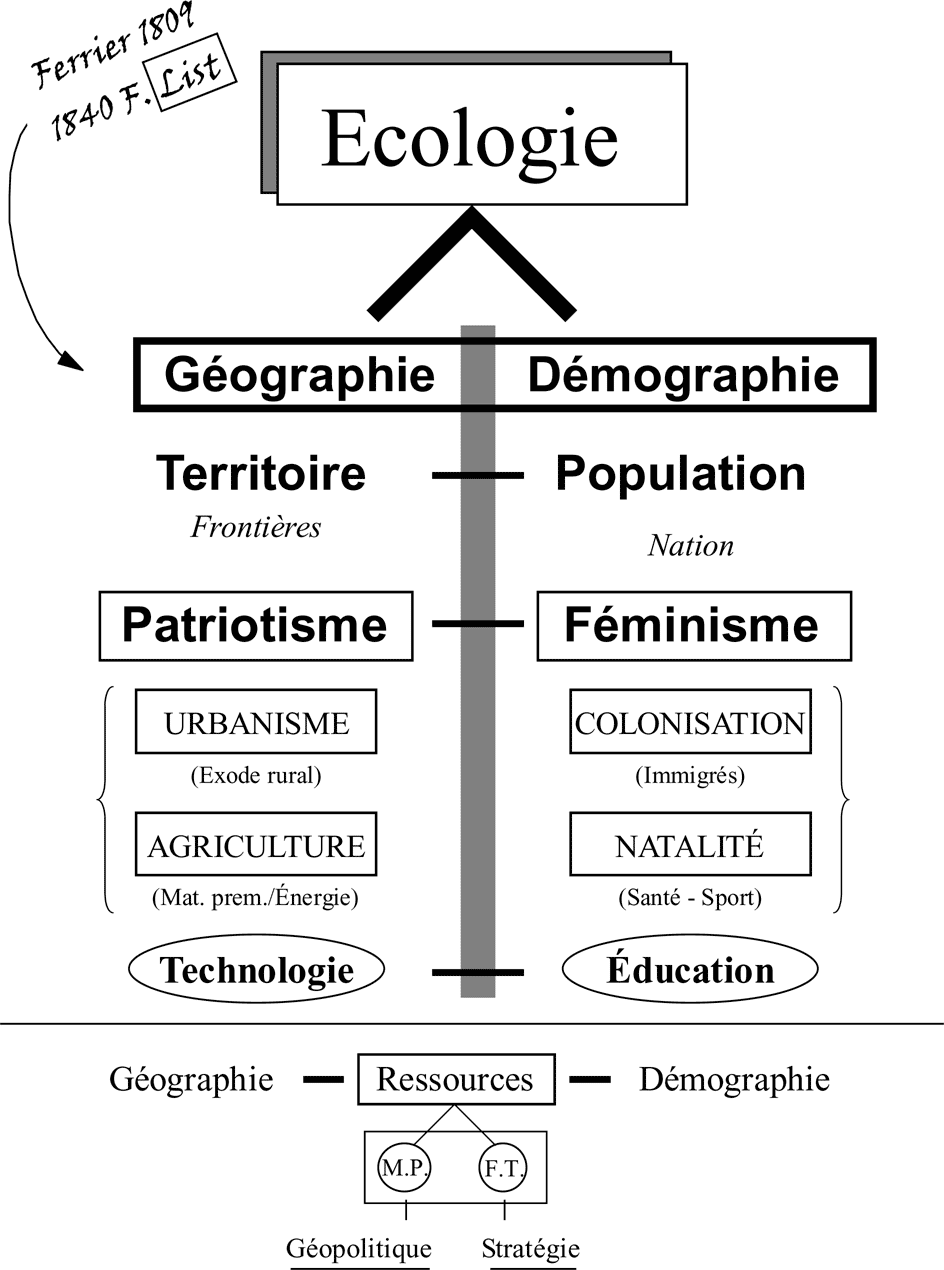
________
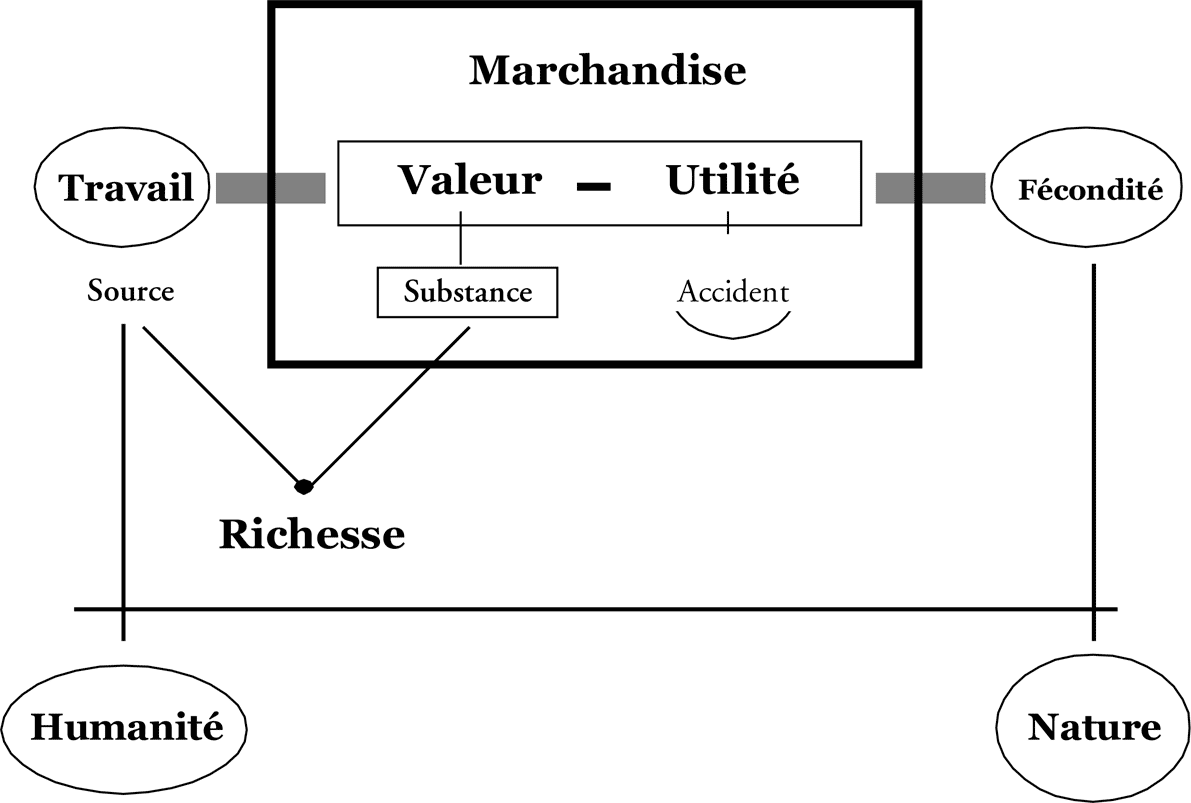
________
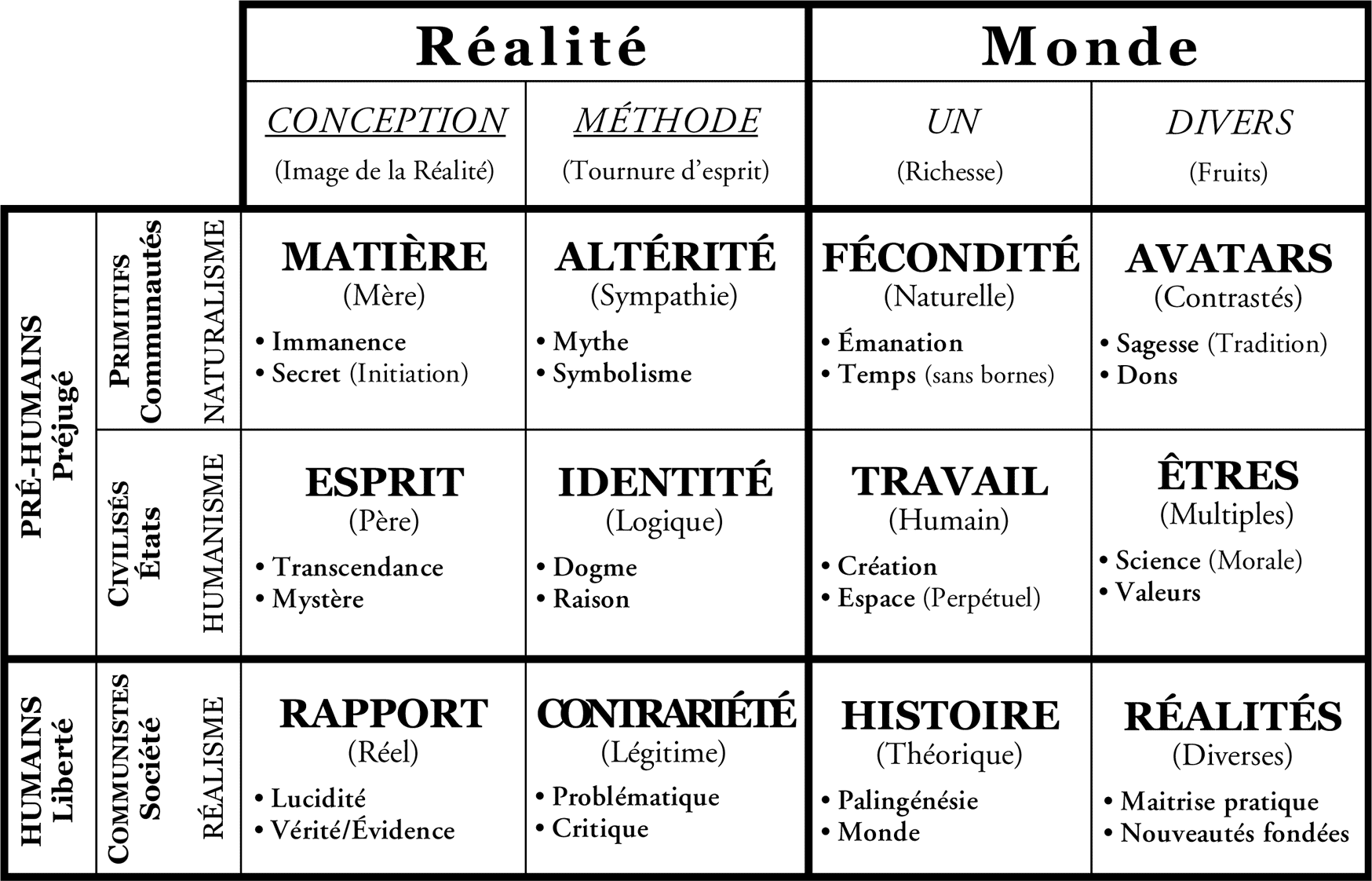
________
________
(Documents)
Hermaphrodite : Parmi les enfants d’Aphrodite, on mentionne une fille, Harmonia, qu’elle eut d’Arès et qui épousa Cadmos, et un garçon, Hermaphrodite, dont le père était Hermès.
Pour dissimuler sa faute, Aphrodite confia cet enfant dès sa naissance aux nymphes de l’Ida, qui l’élevèrent dans les forêts. Parvenu à l’âge de quinze ans, Hermaphrodite, d’humeur sauvage, se plaisait aux longues courses parmi les montagnes boisées. Un jour, se trouvant en Carie, il arriva au bord d’un lac limpide, dont la fraîcheur l’incita à se baigner. La nymphe Salmacis, qui régnait sur ce lac, l’aperçut et s’éprit de sa beauté. Elle le lui dit ; en vain l’adolescent timide voulut-il la repousser ; Salmacis déjà enlaçait ses bras autour des siens et l’enveloppait tout entier de ses embrassements. Ne pouvant vaincre la résistance du jeune homme, la nymphe s’écria : “Tu te débats en vain, cruel ; dieux, ordonnez que rien ne puisse jamais le séparer de moi ni me séparer de lui.” Aussitôt les deux corps n’en formèrent plus qu’un seul.
“Sous une double forme, ils ne sont ni homme ni femme ; ils semblent n’avoir aucun sexe et les avoir tous les deux.”
À la suite de cet événement, les eaux de ce lac reçurent la propriété de faire perdre leur vigueur à ceux qui s’y baignaient. C’était l’accomplissement du vœu suprême qu’avait formulé Hermaphrodite, avant d’être définitivement entraîné par Salmacis dans les profondeurs des eaux.
On a voulu voir dans cette fable singulière une survivance du culte de l’Aphrodite barbue, qu’on vénérait à Chypre.
________

Ardhanârîçvara.
Aspect androgyne du dieu Çiva.
________
L’histoire est contée par Brahmâ aux dieux et aux richis.
« Dans la nuit de Brahmâ, tous les êtres étant confondus dans une même immobilité silencieuse, j’aperçus le grand Nârâyana, l’âme de l’univers aux mille yeux omniscients, à la fois être et non-être, penché sur les eaux sans forme, supporté par le serpent aux mille têtes de l’Infini. Et moi, ébloui par son éclat, je touchai l’être éternel et lui demandai : “Qui es-tu ? Parle.” Alors lui, levant vers moi ses yeux de lotus encore ensommeillés, se leva, sourit et dit : “Sois le bienvenu, mon enfant, Seigneur resplendissant !” Mais, offensé, je répondis : “Comment peux-tu, dieu sans péché, me traiter comme un maître son élève et m’appeler enfant, moi qui suis la cause de la création et de la destruction, le créateur de mille univers, la source de tout ce qui existe ? Pourquoi prononces-tu des paroles insensées ?” Vichnou répondit : “Ne sais-tu pas que je suis Nârâyana, créateur, préservateur et destructeur des mondes, le mâle éternel, la source immortelle et le centre de l’univers ? Toi-même tu naquis de mon corps impérissable.”
Et nous discutions tous deux avec âpreté au-dessus de la mer sans forme, lorsque apparut à nos yeux un glorieux linga étincelant, un pilier flamboyant ayant l’éclat de cent feux capables de consumer l’univers, sans commencement, sans milieu, sans fin, incomparable, indescriptible. Le divin Vichnou, troublé comme moi devant ces milliers de flammes, me dit alors : “Il nous faut chercher la source de ce feu. Je descendrai, toi tu monteras, de tout ton pouvoir.” Alors il prit la forme d’un sanglier, comme une montagne de bleu collyre, avec des défenses aiguës, un groin allongé, un grognement sonore, les pieds courts et solides, vigoureux, irrésistible ; il plongea dans les profondeurs. Pendant mille ans il descendit, mais il ne toucha pas la base du linga. Cependant, je m’étais mué en cygne, tout blanc, aux yeux ardents, avec de grandes ailes, et ma course était rapide comme le vent et la pensée. Je m’élevai durant mille années pour trouver le faîte du pilier, mais sans pouvoir l’atteindre. En revenant, je rencontrai le grand Vichnou qui s’en retournait lui aussi, las et déconcerté.
Alors Çiva se tint devant nous, et, domptés par sa magie, nous nous inclinâmes devant lui. De toutes parts s’élevait le son Aum, éternel et clair. Vichnou lui dit : “Notre dispute a été heureuse, ô Dieu des Dieux, puisque tu nous apparais pour y mettre fin.” Alors Çiva lui répondit : “Tu es en vérité le créateur, le préservateur et le destructeur des mondes ; mon enfant, maintiens en ce monde à la fois l’inertie et le mouvement. Car moi, le Seigneur suprême, indivisé, je suis les trois : Brahmâ, Vichnou et Çiva ; je crée, je maintiens, je détruis”. »
La variété même de ces combinaisons, leur caractère en quelque sorte interchangeable, démontrent bien que les dieux sont en fin de compte réductibles les uns aux autres, suivant le point de vue adopté par l’adorateur.
Sous le fourmillement polythéiste qui anime la mythologie hindoue, se cache une profonde doctrine de l’unité. “Dieu est Un”, dit le Rig-Véda, “mais les sages (vipra) lui donnent des noms divers”.
________
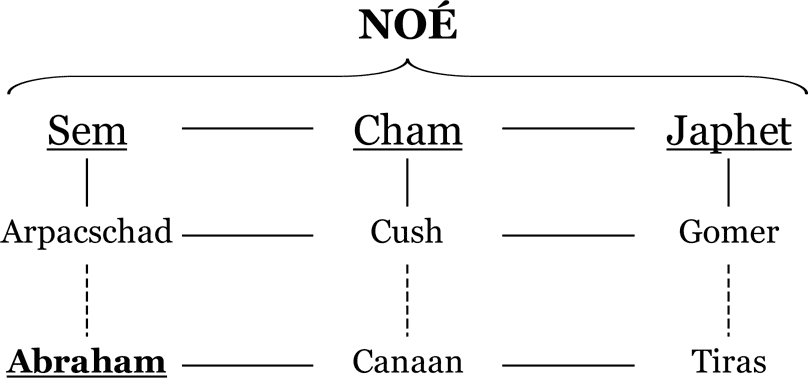
Noé déclare Iaweh “Dieu de Sem”.
Les Sémites sont : Élam, Assyrie, Chaldée, Syrie ; Hébreux, Arabes, Lydiens.
On a constamment affirmé que les Noirs descendaient de Cham, et les Aryens (indo-européens) de Japhet.
________
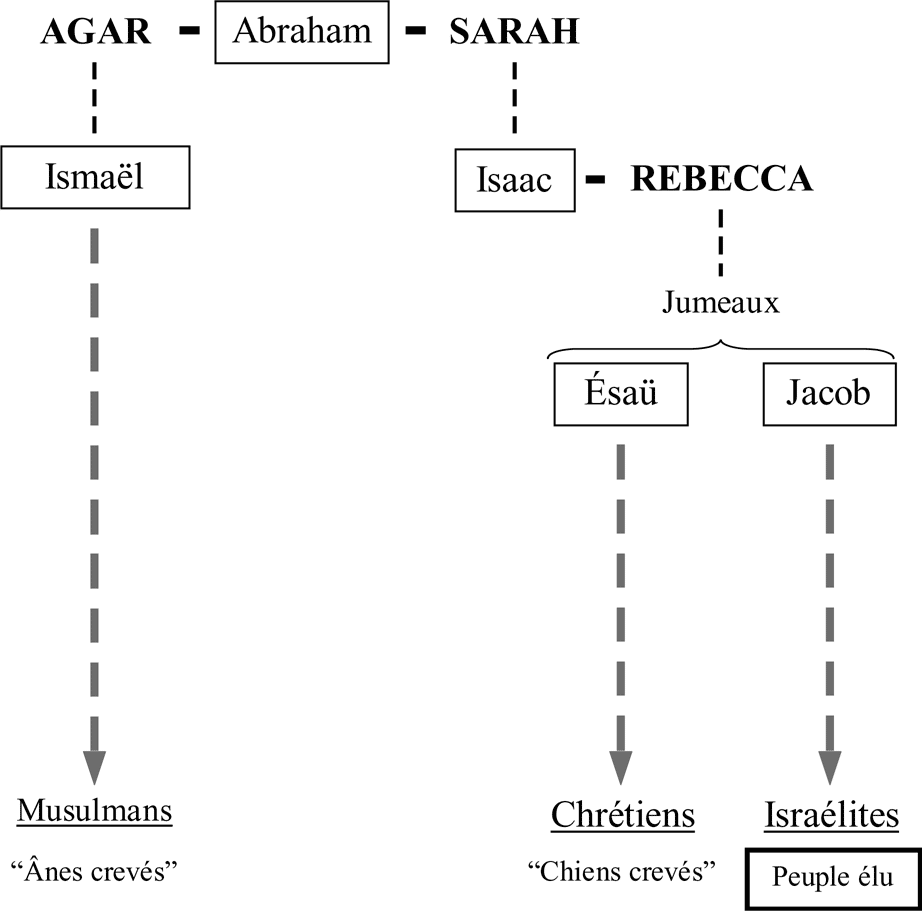
________
L’auteur de la Kabbala denudata, Knorr de Rosenroth, avance dans la préface du tome II, p. 7, que dans tout le Zohar on ne rencontre pas le moindre blasphème contre Notre-Seigneur : Adde quod eliam contra Christum in toto libro ne minimum quidem effutiatur. Cette assertion a été répétée par tous ceux qui depuis Knorr ont écrit sur la Cabale, sans en excepter les deux auteurs juifs, Peter Beer, et M. Franck. Celui-ci dit, comme s’il s’en était bien assuré : “Et l’on n’y rencontre pas une seule fois le nom du christianisme ou de son fondateur”. Nous demanderons ce que devient le passage suivant, tome III, fol. 282 recto de l’édition d’Amsterdam, 1771 ? Il y est question de la terre sainte.
“Le terrain du jardin est mêlé de fumier, fumier infect, car le fumier est composé de toutes sortes d’ordures et de charognes de bêtes impures. On y jette des chiens crevés, des ânes crevés. Là (dans la terre sainte) sont enterrés des enfants d’Ésaü et d’Ismaël (des chrétiens et des mahométans) ; là sont enterrés Jésus et Mahomet, l’un incirconcis (les mahométans opèrent la péritomie d’une manière différente des juifs), l’autre immonde. Ce sont des chiens crevés, c’est un tombeau d’idoles”.
________
Dans la Bible – le Code juif –, les questions de Fécondité et de Matriarcat dominent tout le Mythe matérialiste. À cela s’associe un conflit permanent entre le droit du “premier-né” de fait, et la règle impérative de la descendance en ligne maternelle.
•••
Jéhovah ne cesse de réitérer sa promesse à Abraham et ses descendants : “Je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous les pays d’alentour, et les étrangers se réjouiront de sa domination”.
Les parents de Rebecca bénissent celle-ci à son départ de Haute-Babylonie en disant : “Puisses-tu devenir des milliers de fois 10 000, et ta postérité s’emparer de la porte de ses ennemis” (porte = frontières et enceintes).
•••
C’est en même temps la femme d’Abraham et sa demi-sœur.
Sarah, toujours stérile à 75 ans, c’est elle qui décide d’offrir à son mari Abraham la faculté de se ménager une descendance au moyen de l’esclave domestique Agar. De là naît le premier-né Ismaël.
Sarah, devenue féconde de façon inespérée à 90 ans, conteste le droit du premier-né, fait prévaloir le droit maternel supérieur, dès qu’elle donne le jour à Isaac. Elle fait donc bannir Agar et son fils au désert ; ce à quoi Abraham doit consentir.
Le judaïsme donne à cet enfant d’Abraham le titre méprisant de “fils de l’esclave égyptienne”. Pourtant, Iawéh avait déclaré au Patriarche :
“Ismaël sera fécond, je le multiplierai beaucoup. Il produira 12 chefs et je le ferai devenir un grand peuple”.
Ismaël devient chasseur nomade, un “zèbre d’homme”. Et comme chez les primitifs, la guerre et la chasse ne sont pas différenciées, Ismaël est également un noble brave.
Ismaël n’a pas rompu avec Abraham, puisqu’il participe à l’inhumation de son père.
Ismaël, quoique circoncis, prend une femme égyptienne. Il en eut les 12 fils annoncés, tous bédouins. Il faut se souvenir pour la suite qu’une des filles d’Ismaël se mariera avec Ésaü...
Abraham a donc un fils en ligne maternelle, son cadet Isaac. Isaac ne peut épouser une palestinienne. Son père a le devoir d’envoyer chercher pour lui une femme juive dans sa famille maternelle en Haute-Babylonie. On en ramène Rebecca, “cousine” d’Isaac et petite-nièce d’Abraham.
Rebecca arrivée, elle ne “devint la femme” d’Isaac qu’après que celui-ci l’ait “fait entrer dans la tente de sa mère Sarah”.
Rebecca est stérile pendant 20 ans. Elle accouche de jumeaux à l’âge de 60 ans : Ésaü qui sort “le premier” du ventre, et Jacob.
Jacob, dont le nom deviendra “Israël”, est partisan de l’agriculture et de la vie sédentaire. Pour qu’il épouse une israélienne attestée en ligne maternelle, Rebecca fait décider Isaac d’envoyer Jacob en Haute-Babylonie pour y trouver une femme.
Ésaü adore la chasse, la vie nomade et de vaillant guerrier. Il vit avec une femme palestinienne.
Isaac veut bénir son successeur de droit, le premier-né, Ésaü. Mais Rebecca le trompe, substitue le cadet Jacob devant son mari aveugle au moment de la cérémonie. Ainsi, contrairement à la règle, “l’aîné servit le cadet”.
________
La force du texte hébreu de la Genèse indique l’action de l’amour dans la création du monde. Ces paroles que nous traduisons ainsi : L’Esprit de Dieu était porté sur les eaux, superferebatur, signifient dans l’hébreu incubabat, instar volucris ova calore animantis ; c’est-à-dire que “l’Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit (qui est amour) se reposait sur les eaux, comme pour les animer par sa vertu et sa fécondité divines, et pour en produire toutes les créatures de l’univers, comme un oiseau se repose sur ses œufs, et les anime peu à peu par sa chaleur pour en faire éclore ses petits” (Saint Jérôme cité dans la traduction de la Bible par Sacy).
•••
“Il fut un temps d’avant les nuits et les jours.
Alors celle que nous connaissons à présent comme la Mère secrète du monde, ne se signalait encore qu’à elle-même :
- Par l’abîme de ses Eaux immenses et troubles,
- Qu’elle couvait patiemment tout entier de sa chaude Haleine”.
Freddy Malot – mars 1998
________
L’économie des sociétés primitives
par Marshall Sahlins – 1972
On admet couramment que la vie au paléolithique (âge de la pierre taillée) était dure. À ce sujet, nos manuels s’efforcent de perpétuer un sentiment de fatalité menaçante, au point qu’on en vient à se demander, non seulement comment les chasseurs-collecteurs faisaient pour vivre, mais si l’on peut appeler cela vivre ! On y voit l’homme traqué par le spectre de la famine ; son incompétence technique, dit-on, le contraint à peiner sans répit pour obtenir tout juste de quoi ne pas mourir de faim, sans que lui soit accordé, ni sursis, ni surplus, ni loisir pour “produire de la culture”.
•••
Portrait académique du Primitif :
“Paresse”, “Indolence”, “Nonchalance”, “Indifférence au perfectionnement de son équipement technologique”, “peu soigneux de son bien”, crasseux, miséreux, gaspilleur, “prodigue”, goinfre, “instable en matière économique”, marqué par un “défaut de sens pratique”, totalement “imprévoyant et inconscient”.
“Bref, l’homme paléolithique, est-on tenté de dire, est l’homme-non-économique”.
Julian Steward parle des Indiens Shoshones (1859) :
“Il est du manger parmi les Sauvages, comme du boire parmi les ivrognes d’Europe ; les âmes sèches et toujours assoiffées expireraient volontiers dans une cuve de vin grec (malvoisie) ; et les Sauvages dans une marmite pleine de viande ; les premiers ne parlent que de boire et les seconds n’ont qu’une idée : manger”.
•••
Le Travail :
Martin Gusinde parle des Indiens sud-américains Yamana (1931) :
“Les Yamana sont incapables de fournir chaque jour un effort soutenu, au désespoir de leurs employeurs européens, fermiers et autres. Ils travaillent par à-coups, parfois en déployant une énergie considérable ; après quoi, ils manifestent le besoin de prendre un repos extraordinairement prolongé, et traînent sans rien faire et sans apparence de vraie fatigue. Le patron s’arrache les cheveux, mais l’Indien n’y peut rien : c’est sa nature”.
James Woodburn parle des Hazda, du fin-fond de l’Afrique (1966) :
“Les chasseurs Hazda ont refusé tout récemment d’adopter les pratiques agricoles, alléguant pour motif principal que cela entraînerait trop de travail”.
•••
La Propriété :
Martin Gusinde, en 1931, insistait sur le point-clef :
“Les (sauvages) Yahgan ne savent pas prendre soin de leurs biens. Personne ne pense jamais à les ranger, les plier, les sécher ou les laver, ou bien à les rassembler d’une manière ordonnée. S’ils cherchent quelque chose, ils mettent sens-dessus-dessous le fouillis de leurs petits paniers. Les objets les plus volumineux forment un grand tas dans la hutte : on les bouscule en tous sens, sans souci des dégâts possibles. L’Européen a le sentiment que les Indiens n’attachent pas la moindre importance à leurs ustensiles, et qu’ils oublient complètement l’effort qu’ils leur ont coûté. À vrai dire, personne ne tient aux quelques biens et effets qu’il possède”.
Les Sauvages “répugnent à posséder plus d’un exemplaire des objets d’usage courant”.
“Un Européen serait ahuri de l’incroyable indifférence de ces gens, qui traînent dans une boue épaisse des objets flambants neufs, des habits précieux, des provisions fraîches et des articles de valeur, ou les abandonnent aux enfants ou aux chiens. Ils affectionnent pendant quelques heures, par curiosité, les choses précieuses qui leur sont offertes, après quoi ils les laissent étourdiment se détériorer dans la boue sans plus s’en soucier. On peut dire qu’ils sont totalement indifférents à la propriété”.
Van der Post parle des Bochimans du Kalahari (1958) :
“Le chapitre des cadeaux nous donna plus d’un motif d’embarras. Nous étions mortifiés de constater que nous ne pouvions pas offrir grand-chose aux Bochimans. Ils ne possédaient presque rien : une ceinture, une couverture de peau, et une sacoche de cuir. Ils n’ont pas le sens de la propriété”.
Sahlins l’Utopiste répond aux colons :
De l’enquête générale faite auprès des hommes “paléolithiques” – pourtant la plupart relégués de nos jours dans des conditions défavorables –, il ressort que la quête de nourriture leur coûte, en moyenne par personne et par jour, 4 à 5 heures de travail, parfois moitié moins.
•••
Le travail des chasseurs-collecteurs n’est jamais soutenu. Il cesse dès qu’on s’est procuré de quoi vivre. Il reste toujours en-deça des ressources naturelles accessibles, et ne pousse pas l’effort humain à sa limite possible. Il n’est guère fatigant.
•••
Les Sauvages n’envisagent pas les tâches alimentaires comme un travail pénible ou désagréable, dont il faudrait se débarrasser ; ni non plus comme un mal nécessaire, que l’on repousserait jusqu’au dernier moment (Mac Carthy, en 1960, à propos des Aborigènes d’Australie).
•••
En dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs-collecteurs connaissent une abondance sans égal.
Le travail paléolithique leur apporte dans l’ensemble plus qu’ils n’ont besoin ; l’excédent est donné aux chiens.
Les Fuégiens (Amérique du Sud) se procurent et fabriquent leurs outils et ustensiles sans grand-peine ni effort (Gusinde). Ils les perdent souvent et les remplacent tout aussi facilement (Gusinde).
Le chasseur habile ou chanceux ne se constitue de réserves qu’au prix de son honneur (Rich. Lee – 1969).
C’est littéralement ce que l’on peut dire du chasseur-collecteur, que sa richesse lui est un fardeau (Sahlins).
•••
À côté de ce travail, les Sauvages “jouissent de loisirs surabondants”, passent leur temps en bavardages, en commérages, à faire et recevoir des visites, beaucoup à danser. Outre à manger, ils passent beaucoup de temps à traînasser à l’ombre ou près du feu, à paresser, à vaquer, et énormément à dormir : soit après manger, soit au retour de la chasse, soit durant la cuisson du gibier.
•••
Les Sauvages sont “pauvres mais libres” (Sahlins).
“Ils sont étrangers à l’ambition et l’avarice ; il leur suffit de vivre, de jouir de l’existence”.
“Les Sauvages pourraient avoir pour devise : pourvu qu’on ait de quoi manger aujourd’hui, peu importe ce que demain nous réserve”.
“Ce qui caractérise les Sauvages est leur confiance en soi et en l’avenir”.
“Les Sauvages se livrent sans grand effort à la chasse et la cueillette, là où la nature a constitué, à sa façon, des stocks considérables de nourriture qui, par la variété et l’abondance, l’emportent sur tout ce que l’homme peut mettre de côté”.
“En vérité, les Sauvages savent qu’ils n’ont rien à craindre de l’avenir. [Aussi ne font-ils pas de provisions]. Bon an, mal an, ils peuvent attendre le lendemain sans soucis” (Gusinde).
Richard Lee rapporte une parole des Bochimans (1968) :
“Pourquoi planterions-nous, alors qu’il y a tant de noix de mongo-mongo dans le monde ?”.
•••
Sahlins :
“Les hommes paléolithiques ignorent l’obsession de la Rareté qui est caractéristique de l’économie de marché. L’économie de chasse et de cueillette (et ramassage) mise systématiquement sur l’Abondance”.
“L’ère de la famine sans précédent, c’est la nôtre”. “La pauvreté est une invention de la civilisation”.
Sahlins cite Marx, qui s’attaque à Destutt de Tracy, l’économiste-vedette de la Libre-Pensée, exécré par Napoléon (les “idéologues”). Marx appelle Destutt un “doctrinaire bourgeois à sang de poisson”. Il ajoute : “dans les nations pauvres, les gens sont à leur aise, alors que dans les nations riches, ils sont généralement pauvres” (c’est-à-dire la masse).
Le Père Biard, Jésuite, parlait des Indiens “Micmac” de la Nouvelle-France en 1616 :
“Jamais (le roi) Salomon n’eut son hôtel mieux ordonné et policé en vivandiers. Pour bien jouir de ce leur appanage, nos sylvicoles s’en vont sur les lieux d’icelui avec le plaisir de pérégrination et de promenade, à quoi facilement faire ils ont l’engin, et la grande commodité des canots, qui sont petits esquifs, si vite à l’aviron qu’à votre bel-aise de bon temps, vous ferez en un jour les trente et quarante lieues. Néanmoins on ne voit guère ces Sauvages postillonner ainsi : car leurs journées ne sont tout que beau passe-temps. Ils n’ont jamais haste. Bien divers de nous qui ne saurions rien sans presse ni oppresse !”.
Sahlins :
“La tranquillité en matière économique des chasseurs-collecteurs est fondée sur le fait qu’en temps normal, tout le monde trouve à satisfaire ses besoins de subsistance. Cette belle assurance leur devient une seconde nature et, c’est le rire aux lèvres qu’ils traversent des épreuves telles qu’un Jésuite a peine à les endurer.
Le Père Paul Lejeune, en 1634, dit :
“Je voyais les Indiens souffrir avec allégresse dans leurs peines, dans leurs travaux. Ils me disaient : nous serons quelquefois deux jours, parfois trois, sans manger. Prends courage, Chichiné ! Aie l’âme dure, résiste à la peine et au travail ! Garde-toi de la tristesse, autrement tu seras malade ! Regarde : nous ne laissons pas de rire, quoique nous mangions peu”.
Sahlins :
“La grande affaire, pour les chasseurs-collecteurs, c’est leur Santé, un objectif précis, et l’arc et les flèches sont appropriés à ce but.”
D’après L’économie des sociétés primitives, de
Marshall Sahlins (1972),
Freddy Malot – mars 1999
________
Rome, la Rome antique : ce nom évoque irrésistiblement la patrie du Droit. Que n’a-t-on pas écrit sur le “droit romain” ! Mais il reste à le comprendre…
Par exemple : le droit du propriétaire “d’user et abuser” a constamment été présenté de manière anachronique. Ce droit si absolu dans la forme l’était pour la seule raison qu’il était absolument fragile sur le fond. En effet, le patricien romain n’était propriétaire que parce que citoyen, à l’inverse du bourgeois Moderne, qui fut citoyen parce que propriétaire. Ce sont ces petits détails qui échappent à nos grands Universitaires de Musée !
•••
On imagine, du coup, à quel point tout ce qu’on a pu nous raconter sur le Ménage romain, le “pater familias” et la suite, peut être délirant.
Je donne des extraits du traité de “la Société Domestique” de l’abbé Gaume, paru en 1854 :
• Dans le T. I, ch. VIII, l’auteur dit :
“La nature ne fut comptée pour rien dans l’organisation de la famille romaine. Elle eut pour base non les liens du sang, mais le lien civil”. Par “lien civil”, il veut dire lien juridique.
• Dans le T. II, Ch. XI, l’auteur dit :
La société romaine “violait les lois de la nature ; les liens de famille trop resserrés, enfantaient l’égoïsme. Pour mettre le mariage à l’abri de toute corruption, l’Église établit ses empêchements. (Relativement à) la consanguinité, l’Église défend entre chrétiens toute union conjugale dans les degrés les plus rapprochés. Elle veut qu’ils ne puissent s’unir qu’à une distance où les liens du sang ne suffisent plus à entretenir l’intimité fraternelle”.
Ainsi, le bon abbé ultramontain, qui ne comprend rien à l’affaire du Ménage civilisé, à sa naissance et son développement, dit n’importe quoi pour défendre les Zouaves Pontificaux…
•••
Tout s’éclaire facilement pourtant, si on examine la chose de façon historique et critique.
Les Romains barbares, provoqués par la civilisation grecque, refondent pour leur compte ce même ordre civilisé, en se dressant contre l’Asiatisme étrusque.
Repères : Romulus – 753 A.C. ; République – 509 A.C.
La grande vague civilisatrice nouvelle, prise en charge par les Romains, se signale évidemment en instituant de façon brutale et tranchée l’union conjugale juridique, qui place le lien sexuel de procréation sur le terrain spirituel et moral. Or, la révolution romaine en ce domaine est autant “radicale” dans le principe qu’elle est “inconséquente” en fait.
Je m’explique. Certes, le Ménage privé instauré signifie le retournement de l’Endogamie primitive en Exogamie civilisée. Cela est acquis dès le premier instant. Mais la matière sur laquelle cette opération s’exerce est celle des liens du sang des tribus du Latium, lesquels ne peuvent s’effacer d’un trait de plume. Aussi, le Juridisme romain ne peut-il faire, dans un premier temps, qu’envelopper la réalité “raciale” préexistante. Autrement dit, le Ménage romain s’établit sous la forme la plus “simple” qui soit, la plus “inconséquente” possible.
Tout ce que fait l’abbé Gaume, c’est de souligner que le stade romain n’est que le premier de la série civilisée, et que la société chrétienne opérera à son tour un bond qualitatif dans le sens du perfectionnement du ménage privé. Oui, la société chrétienne contribua puissamment à acheminer le ménage privé vers son état “pur” final, celui du monde Moderne. Mais le passage à cet état achevé ne fut possible, n’en déplaise à l’abbé Gaume, qu’en rompant violemment avec le Ménage médiéval, de la même manière que ce dernier avait rompu avec le Ménage antique. Et c’est Luther qui donna le coup de bélier contre la dévote et “paternaliste” famille chrétienne, qui se montrait à son tour horriblement inconséquente à la fin du 15ème siècle. Notre ami de Pie IX a une merveilleuse formule pour caractériser le cycle du perfectionnement du Ménage civilisé ; il dit : “Le paganisme ancien faisait du père un despote ; la philosophie moderne en fait un valet”. Ceci, bien compris, explique tout. Mais l’abbé Gaume tient à l’entre-deux, au papa “protecteur” gothique ; la révolution qu’il loue St Paul d’avoir déchaînée, il refuse à Luther le devoir de l’achever. Hélas ! Comme dit Mao : l’arbre préfère le calme, mais le vent lui arrache cependant les branches.
•••
• On s’étonne que, dans les premiers temps de Rome, les Enfants, à leur naissance, soient tenus pour une “chose” par le Père (on feint de se scandaliser du fait analogue concernant l’Esclave antique). Que dire de cela ?
La civilisation institue le rapport spiritualiste Sujet-Objet, qui était totalement étranger aux Primitifs, et même directement contraire à toute leur mentalité. Or, il n’y a pas de milieu : si l’un est Sujet théorique, l’autre est Objet théorique dès que le rapport se trouve en vigueur. Ensuite, la relation Sujet-Objet s’affirme comme hégémonique, unilatérale ; mais précisément pour cela, en sous-main, les termes se révèlent comme deux contraires absolument identiques ! Le fœtus mis au monde y entre d’abord comme “objet” qu’on le veuille ou non ; il ne présente aucune autonomie d’aucune sorte, et encore moins de Raison. Mais cette “chose” civilisée n’en est pas moins totalement Sujet déjà, ne serait-ce que parce que ce n’est pas l’enfant d’un autre ménage, condition pour qu’il soit plus tard le Sujet d’un ménage privé précis. D’ailleurs, le Père antique même, auquel on reconnaît la qualité incontestable de Sujet, que nous montre-t-il quand il déclare son propre suicide comme un acte de haute moralité dans des conditions données ? Il traite alors naïvement son propre corps comme un objet, et le suicide “stoïque” est l’occasion de faire briller sa qualité de Sujet. La mort de Socrate ne nous touche-t-elle pas ?
• On s’étonne que le Père antique initial ne coïncide absolument pas avec le statut de Mari. En effet, le vrai “Père” de la vieille Rome est Chef de ménage de toute sa lignée ; et son fils, même marié et ayant des enfants, reste sous sa “puissance”. Il n’y a aucun mystère dans ce fait, et encore moins objet de scandale. C’est toujours l’histoire de la nécessité de commencer par la forme “simple” du Ménage privé, l’obligation du Ménage privé premier d’épouser les contours de l’ancienne société parentale-ethnique préexistante.
• On s’étonne de ce que l’Épouse antique initiale entre dans le ménage privé en revêtant le statut de “fille” de son mari et, par suite celui de “sœur” de ses propres enfants. Là encore, cette fiction juridique de l’adoption de l’épouse par son mari est très compréhensible : la veille de son mariage, elle était fille de son propre père ; la forme la plus simple de l’union conjugale est par suite d’abandonner ce titre antérieur et de le voir transporté dans le ménage auquel elle va s’incorporer.
• Tous les autres aspects qui peuvent nous paraître étranges dans le ménage romain initial ont alors un intérêt secondaire, et ils deviennent limpides et cohérents. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat en traitant de l’héritage centralisé romain, du mariage “par achat”, de “l’exposition des enfants”, et ainsi de suite.
Freddy Malot – mars 1999
________
chez tous les peuples anciens et modernes
ou
Influence du Christianisme sur la famille
Par l’Abbé J. Gaume – 1854
Histoire de la Famille en Europe, chez les Romains — Première époque depuis la fondation de Rome jusqu’aux décemvirs.
Les fleuves arrivent à leur embouchure, charriant les immondices qu’ils ont recueillies sur leur passage à travers les villes et les campagnes ; ce dégoûtant tribut qu’ils versent dans son sein, la mer le rejette en écume sur ses bords : ainsi le flot de corruption dont nous avons suivi le cours à travers les siècles chez les différents peuples de l’Orient et de l’Occident, vint se jeter dans l’océan de la corruption romaine, qui le renvoya plus impétueux et plus infect jusqu’aux limites de l’Empire. Cette double action du monde sur Rome et de Rome sur le monde va maintenant nous occuper. Aux détails sur la famille romaine nous donnerons une certaine étendue. On nous le permettra d’autant plus volontiers, que ses lois et ses mœurs sont le résumé trop fidèle des lois et des mœurs de la société domestique chez les autres nations païennes ; en sorte que les lumières plus vives qui jailliront de nos études serviront à éclairer les parties du tableau précédent qui auraient pu rester dans l’ombre.
[I-] Chef de brigands, et père d’un peuple destiné par la Providence à l’empire du monde, Romulus, accoutumé à ne reconnaître d’autre loi que celle de la force, imprima son caractère aux rudiments de législation qu’il donna à sa peuplade. La nature ne fut comptée pour rien dans l’organisation de la famille romaine. Elle eut pour base non les liens du sang, mais le lien civil de la puissance. Pour être membre de la famille, le titre d’enfant ou d’épouse ne suffisait pas ; il fallait encore être sous la puissance du père. Ainsi le fils émancipé cessait de faire partie de la famille ; ainsi la nouvelle épouse entrait dans la famille non par sa qualité d’épouse, mais par l’adoption civile de son mari actuellement sous la puissance paternelle. De là, pour l’enfant, une série de conséquences dont la rigueur logique fait frémir.
[II-] Et d’abord, le pouvoir paternel des Romains, porté à un degré inconnu des autres nations, s’étendit jusqu’au droit de propriété absolue sur les enfants, les petits-enfants et au-delà. En conséquence, la vie et les biens de tous les enfants et des petits-enfants issus des fils en puissance, furent, entre les mains du père de famille, comme une chose entre les mains du propriétaire. Leurs acquisitions soit par industrie, soit par donations, soit par testament, appartenaient au père, qui était ainsi l’héritier universel de sa lignée. “Nous acquérons, dit Ulpien, par les personnes qui sont sous notre puissance”. Les commentateurs du droit romain expliquant ce texte ajoutent : “Le père acquérait par son fils... les enfants héritaient pour leur père, et le père, s’ils avaient un pécule, en était l’héritier”.
Tout en blâmant cette exagération de droits accordés à la puissance paternelle, on ne peut s’empêcher de reconnaître dans ce pouvoir absolu sur plusieurs générations, un principe de force et d’unité qui devait nécessairement réagir sur la société politique. La puissance du lien de famille fut, à n’en pas douter, une des causes de la grandeur romaine.
En vertu du même droit de propriétaire, le père pouvait exposer ses enfants, les tuer, les vendre et les racheter : trafic horrible que la législation subséquente l’autorisa, par un acte spécial, à exercer jusqu’à trois fois. Ce droit ne cessait qu’après la troisième vente, ou par l’émancipation, ou par le mariage revêtu de l’assentiment paternel. Nous reviendrons sur ce point essentiel, en expliquant les lois des Douze-Tables.
Cependant la nécessité d’augmenter son peuple naissant obligea Romulus à mettre une restriction à ce droit homicide, dont les conséquences eussent été l’anéantissement infaillible de la république encore au berceau. Il enjoignit aux pères de famille d’élever tous leurs fils et l’aînée des filles ; défendit de tuer l’enfant, quel que fût son sexe, âgé de plus de trois ans, et restreignit le droit d’exposition au fils disgracié de la nature et à toutes les filles puînées. Nous verrons plus tard avec quelle facilité on renversa ces faibles barrières, et comme on se joua impunément de la vie des nouveau-nés.
[III-] Dérivée de la même source que le pouvoir paternel, la puissance maritale revêtit le même caractère et prit la même extension. Passée sous la puissance de son mari, non point en vertu du mariage considéré comme contrat naturel, mais comme adoption civile, la femme prend dans la famille la qualité de fille relativement à son mari, et de sœur consanguine relativement à ses propres enfants. Son mari devient le maître absolu de sa personne et de ses biens, comme il l’est de la personne et des biens de ses propres enfants. S’il meurt, elle héritera de lui, non comme épouse, mais comme fille adoptive de ce père civil. Une seule chose lui manquera toujours, c’est la liberté. La puissance paternelle qui la domine n’est pas morte avec son mari ; elle a passé dans la personne des agnats, c’est-à-dire du frère, de l’oncle, en un mot des parents de son mari en ligne masculine. S’il n’en existe pas, le mari lui donne un tuteur testamentaire. Développons ce despotique système qui absorbe la femme dans la puissance maritale, comme celle-ci est absorbée dans la puissance paternelle.
[IV-] Le mariage par achat fut seul en usage chez les Romains au temps de Romulus. Numa établit le mariage par confarréation, forme religieuse, patricienne et la plus solennelle de l’union conjugale. Après la publication des Douze-Tables, la loi reconnut encore la possession annuelle ou l’usage. Le mariage n’avait d’effets civils qu’autant qu’il était revêtu de quelqu’une de ces formes légales. Dans tous les cas, il était l’exercice du droit du plus fort, au profit duquel il stipulait la propriété absolue de l’être faible.
[A- Romulus :] Et d’abord, la plus ancienne forme de mariage connue chez les Romains, c’est l’achat ou coemption. Telle est en effet la première manière et la plus usitée chez toutes les nations d’acquérir la propriété. On employait donc, pour épouser une femme, des formalités absolument semblables à celles d’un contrat de vente ordinaire. L’acheteur en demandait le prix ; on discutait, on marchandait. Une fois les parties tombées d’accord et la somme payée, la femme devenait la propriété de son mari, et subissait toutes les conséquences de cette condition.
Avant de les exposer, on nous permettra de rappeler que cette ignominieuse condition de la femme, cette dégradation par conséquent de la société domestique, était écrite à chaque page des lois romaines, et jusque sur le marbre des tombeaux. Témoin, entre mille, l’inscription suivante trouvée à Padoue :
PUBL.
CLAVD. QVAEST.
AER.
ANTONINAM – VOLVMNIAM.
VIRGINEM.
VOLENT. AVSPIC.
A. PARENTIBVS. SVIS. COEMIT.
A. FAC. IIII. IN DOM.
DVXIT.
Inutile de rappeler que la vente des femmes était la forme ordinaire du mariage chez tous les peuples de l’antiquité. Que la femme apprenne donc à connaître les conséquences de sa condition chez les Romains, et qu’elle bénisse de toute la puissance de son cœur la religion sainte qui a brisé le joug odieux que le paganisme fit si longtemps peser sur elle.
1- Comme le champ ou la bête de somme prend le nom de celui qui l’achète, la femme perdait son nom pour prendre celui de son nouveau maître. Cet usage subsiste encore aujourd’hui dans le christianisme, quoique la signification en soit bien différente : en le conservant, l’Église a voulu rappeler à la femme non-seulement l’unité de la famille, mais encore un utile souvenir.
2- Elle était frappée d’une incapacité absolue à rien acquérir soit par donation entre vifs, soit par testament, soit de toute autre manière qui n’appartînt à son mari. La condition de la femme à l’égard de son mari, était celle de la fille à l’égard de son père. Or, comme le père acquérait par son enfant, de même le mari acquérait par sa femme. C’est ainsi que les commentateurs entendent le texte d’Ulpien cité plus haut.
3- Comme la propriété fructifie pour son maître, la femme fructifiait pour son mari, non seulement en devenant riche, mais encore en devenant mère. Les enfants sortis de ses entrailles et formés de son sang, étaient non sa propriété, mais celle du mari. Produits de sa propriété, ils étaient à sa discrétion pour la vie et pour la mort. Non seulement les fils et les filles, mais encore leurs enfants et petits-enfants étaient soumis à ce pouvoir paternel : le père seul et non la mère en avait l’exercice. C’est pourquoi le père est appelé, par Ulpien, chef de famille.
4- L’essence du droit de propriété étant de pouvoir user et abuser de la chose, c’est-à-dire, de la détruire, de la vendre, d’en céder l’usage ou l’usufruit, de renoncer à sa possession, le mari avait les mêmes droits à l’égard de sa femme. Il pouvait les exercer tous sans exception, et, honte éternelle ! il les exerça tous. “Magistrat domestique, le mari fut investi par Romulus d’un pouvoir absolu sur sa femme. À lui appartint non seulement le domaine des biens, mais encore le droit de vie et de mort.” Tel est le témoignage formel de Denys d’Halicarnasse. En un mot, il n’est aucun des droits de la puissance paternelle, entendue comme nous avons vu, que le mari ne pût exercer sur la femme qu’il avait achetée.
C’est lui qui punissait son épouse coupable d’ivrognerie, d’adultère ou d’autres fautes ; c’est lui qui la vendait, qui la renvoyait ; que dis-je ? il avait sur cette infortunée créature un droit dont l’immoralité révoltante est cependant consacrée par de trop fameux exemples. Admirateurs des païens, lisez la vie de Caton et d’Auguste, l’un censeur et l’autre réformateur des mœurs romaines, et apprenez à rougir !
5- Dans le cas de répudiation qui devint plus tard l’usage le moins violent de l’autorité maritale, ne pensez pas que la femme jouit de quelque liberté ; non, elle redevenait la propriété de ses agnats ou de ceux qui l’avaient vendue. Nous verrons que les femmes s’affranchirent enfin de ce joug de fer, mais pour tomber dans une licence effrénée. Du moins, lorsque son mari aura cessé de vivre sera-t-elle délivrée de l’oppression ? Nullement. La puissance maritale se survivra à elle-même pour lui imposer un nouveau joug, celui d’un tuteur. Les lois romaines la condamnaient à ce dernier genre d’esclavage. “De même, disent-elles, que le père de famille peut donner par son testament des tuteurs à ses jeunes enfants ; de même le mari sur le point de mourir donne un tuteur à sa femme, comme à sa propre fille.”
Il s’ensuivait de là, comme complément de ce système de servitude, que les femmes ne pouvaient même disposer de leurs biens après leur mort. Excepté les vestales et les femmes ingénues qui avaient eu trois enfants, et les affranchies qui en avaient eu quatre, toutes les femmes étaient assujetties à la tutelle et par elles-mêmes incapables de tester. Cette exception même, qui du reste ne fut établie que plus tard, révèle, quand on en sait la cause, une des plaies les plus hideuses de la société domestique chez les Romains : nous la ferons connaître en son temps.
Ce n’est pas tout encore. Il s’agissait de perpétuer le joug du tuteur jusqu’au dernier soupir de l’infortunée qui le portait : un despotisme jaloux en trouva le moyen. Les secondes noces furent interdites aux femmes sinon de droit, au moins de fait. L’opinion publique jeta une telle défaveur sur cette union, que la veuve ne pouvait la former sans se flétrir d’une tache ineffaçable. Ce préjugé, en complétant le système d’oppression barbare qui pesait sur la femme, produisit, chez les différents peuples, des conséquences affreuses, entr’autres l’atroce coutume d’immoler ou de brûler les veuves sur le tombeau de leur mari.
Pour ne parler ici que des Romains, il n’est sorte de moyens que la jalousie maritale n’inventât pour ériger en maxime sacrée cette injuste défense. De tout temps la vanité fut le faible de la femme : on la prit par cet endroit sensible. La louange et la flétrissure furent tour à tour prodiguées pour la réduire sur ce point à l’obéissance. Aux seules épouses non remariées fut réservé l’insigne honneur de toucher la statue de la Fortune féminine, de la mère Matuta et de la Pudeur ; seules elles eurent le droit de ceindre leur front de la couronne pudique ; seules elles purent prétendre au sacerdoce si ambitionné des déesses. De là, les éloges magnifiques donnés à Cornélie, mère des Gracques ; de là, les poètes chantant l’éloge d’une autre Cornélie qui avait promis de n’avoir qu’un époux.
Et, en effet, les femmes vaines et crédules ne virent pas le piège qu’on leur tendait, et firent graver sur leur tombeau, comme un titre de gloire, le triomphe de la jalousie et du despotisme marital :
D. M.
REINANIÆ C. F.
MÆCIANÆ
CONJ. INCOMPARABILI
UNIVIRÆ ET CASTISSIMÆ.
En même temps on faisait passer les secondes noces pour être du plus funeste augure. Pour ajouter à la terreur la honte à laquelle une femme est toujours si sensible : “Les anciens Romains, dit Plutarque, obligeaient les veuves à se marier les jours de fêtes publiques, afin de les couvrir de confusion en présence de toute la ville.” De là, enfin, l’empressement des pères et des maris à recommander à leurs filles et à leurs épouses un veuvage perpétuel.
Et qu’on ne dise pas que cette défaveur jetée sur les secondes noces avait pour but d’obtenir plus sûrement la fidélité conjugale et de pourvoir plus efficacement au bien des enfants. Dans ce cas, pourquoi les maris s’attribuaient-ils avec tant d’impudeur le droit de répudier arbitrairement leurs épouses, et d’en prendre une nouvelle du vivant de la première ? La présence d’une prostituée au foyer domestique était-elle donc bien plus favorable aux enfants que celle d’un beau-père ? et puis, les enfants n’appartenaient pas à la femme, ou du moins celle-ci n’exerçait sur eux qu’une faible action, soumise qu’elle était, après la mort de son mari, au gouvernement d’un tuteur.
Nous verrons bientôt que les lois d’Auguste brisèrent ce genre d’oppression. Mais tel était le paganisme : capable de tout mal, il semble incapable de tout bien dans l’ordre moral. En punissant les veuves qui ne passaient pas à de secondes noces, la loi Papia Poppea jeta la femme sous un joug plus dégradant et plus dur que le despotisme marital, le joug d’un libertinage effréné.
Le christianisme, principalement dans les premiers siècles, témoigna aussi de l’opposition aux secondes noces ; mais il n’en fit point un crime : d’ailleurs ses vues étaient bien différentes. L’avantage des enfants du premier lit, la gloire de la femme, la nécessité de spiritualiser les cœurs, tels furent ses motifs.
Ainsi, depuis le berceau jusqu’à la tombe la vie de la femme romaine, dans cette première période, était un esclavage non interrompu ; tel est le dernier mot de son histoire. La même condition était celle de l’enfant : à Rome comme ailleurs le despotisme était donc la loi suprême du foyer domestique.
•••
[B- Numa] Numa, successeur de Romulus, adoucit un peu le sort de la femme, soit en modifiant les droits de tutelle, soit en la rendant habile à hériter de ses parents, soit en établissant le mariage par dot, tout en conservant le mariage par achat. Cette nouvelle forme de contrat matrimonial était la conséquence du droit de posséder reconnu à la femme. Au lieu d’être achetée par le mari, c’est elle-même qui lui donnait une dot en échange de la protection qu’elle lui demandait. De là, naquit la distinction si connue entre les femmes romaines : celles qui avaient été achetées par leur mari s’appelaient mères de famille ; celles qui avaient fourni une dot reçurent le nom d’épouses ou de matrones. Mais telle fut bientôt la corruption des mœurs que ce nouveau mariage devint une source féconde de crimes dans le foyer domestique, et d’avanies pour la femme. On chercha non des épouses, mais des dots. Les femmes les plus décriées trouvèrent des maris ; tandis que les vierges, riches seulement de leurs vertus, se voyaient délaissées. “Il est important au salut de la république, écrivait un jurisconsulte, que les filles conservent soigneusement leur dot ; c’est la seule condition à laquelle le mariage leur soit possible.” Que pouvait-on attendre de mariages contractés pour de semblables motifs ? si ce n’est une dégradation de plus eu plus profonde de la société domestique, des injustices nombreuses, et enfin le scandale éclatant de la répudiation. Ces funestes effets furent longtemps suspendus par la force de l’opinion publique ; mais dans la suite les lois romaines vinrent malheureusement leur donner toute liberté de se produire, en autorisant le mari à renvoyer sa femme dans un grand nombre de cas ; et, suivant la gravité de la cause, à retenir une partie proportionnelle de la dot. On conçoit avec quelle facilité l’époux avare ou dissipateur devait trouver des cas de renvoi. Les femmes, à leur tour, ne furent pas les dernières à en faire naître. Réagissant avec force contre la législation primitive qui les mettait, en cas de veuvage ou de divorce, sous l’autorité des agnats ou du tuteur testamentaire, elles s’affranchirent du joug au point de se choisir elles-mêmes des tuteurs sur lesquels, dit Cicéron, elles régnaient beaucoup plus qu’eux-mêmes ne régnaient sur elles.
Nous verrons toutes les conséquences de cette législation anormale se développer avec le temps, et faisant passer dans l’État l’effroyable corruption de la famille, amener la ruine totale de l’une et de l’autre.
Rendre moins fréquente la violation de sa loi De aldulteriis, et donner à la république des sujets qui n’eussent pas à rougir de leur naissance, tel était le double but du législateur. En conséquence, et dans la même loi Papia Poppea, il crée le concubinat et détermine les règles qui le rendent légal. Mais remarquez bien qu’il ne s’agit point ici du concubinat dans le sens honnête que lui donnèrent la langue et la coutume de certains peuples, chez qui cette union secondaire était aussi inviolable que la première ; c’est le concubinat qui peut cesser par la simple volonté d’une des parties ; c’est le concubinat qui ne produit aucun effet civil à l’égard des enfants. Ils ne portent pas le nom de leur père ; ils ne sont pas ses héritiers ; ils ne sont pas dans sa famille. Seulement, nés d’une union que la loi couvre d’un voile de légalité, ils sont exempts de toute tache infamante.
Par une anomalie qu’explique la constitution de la famille romaine, fondée non sur le sang, mais sur les liens civils, ces enfants, exclus de la succession de leur père, avaient à l’héritage maternel tous les droits des enfants légitimes. La concubine elle-même entrait pour un quart dans la succession du concubinaire. Tel est le concubinat créé par Auguste dans le double but de prévenir l’adultère et de multiplier les citoyens. Cette institution dégradante, vain palliatif au mal qui dévorait la vieille société, est tellement l’œuvre d’Auguste, qu’elle lui doit jusqu’à son nom.
Il nous répugne vraiment de faire descendre le lecteur dans cette fange ; il faut pourtant bien sonder la profondeur de la plaie, si l’on veut apprécier la nécessité et la puissance du remède. Terminons en ajoutant que le concubinat devait rester inférieur à l’union conjugale ; parce qu’il est de sa nature moins favorable à la population.
Sollicitude de l’Église pour la Famille
Semblable à la tendre mère qui ne se contente pas d’avoir donné le jour à sa fille, mais qui veille sur sa vie avec une constante affection, l’Église n’abandonna point la famille qu’elle venait de régénérer. Connaissant la corruption de la nature et tous les artifices du démon irrité de sa défaite, la divine épouse de l’Homme-Dieu n’a cessé de veiller sur la société domestique avec une infatigable sollicitude.
Faire retomber la famille sous le joug honteux du despotisme et du sensualisme, tel sera le but constant des efforts de la malice infernale combinés avec la perversité humaine. À cette double attaque sans cesse renouvelée, l’Église oppose un double rempart : ses lois et l’actif courage de ses pontifes.
Comme on établit autour d’une citadelle des fortifications avancées qui éloignent l’ennemi du cœur de la place, elle commence par entourer de son admirable législation l’acte solennel qui constitue la société domestique. Une confusion révoltante régnait, comme elle règne encore, dans les alliances conjugales chez les différents peuples païens de l’Orient et de l’Occident. Tantôt les mœurs profondément outragées conduisaient à la violation des lois de la nature ; tantôt les liens de famille, trop resserrés, enfantaient l’égoïsme, ou, trop relâchés, aboutissaient à une promiscuité non moins funeste qu’humiliante. Pour débrouiller cet affreux chaos, pour empêcher qu’il ne reparût, c’est-à-dire, pour mettre le mariage à l’abri de toute corruption, l’Église établit ses empêchements. Étudiés avec l’impartialité de la véritable science, ils vous apparaissent comme le système de législation le plus complet et le plus sagement calculé. Non seulement ils environnent d’un respect profond l’acte générateur des sociétés humaines ; ils sont encore l’infaillible moyen d’établir le règne de l’esprit sur la chair et la fraternité universelle, terme final du christianisme sur la terre. Les uns assurent aux contractants la plénitude de liberté requise dans un engagement aussi redoutable ; les autres protègent les droits sacrés de l’être faible contre l’oppression de l’être fort ; ceux-là affermissent le bonheur domestique en mettant un frein à tous les désirs homicides ou coupables ; ceux-ci veillent au maintien des mœurs publiques et à la paix des familles.
Il en est deux surtout qui ont la plus haute importance religieuse et sociale. Le premier, c’est la disparité de culte. Afin de dégager l’humanité chrétienne de la masse corrompue qui l’environne, l’Église creuse un abîme entre elle et le paganisme : sous peine de nullité, elle défend à ses enfants de contracter mariage avec les infidèles. Le second, c’est la consanguinité. En même temps qu’elle interdit à ses disciples toute alliance avec les étrangers, l’Église étend parmi les chrétiens la charité divine dont elle est la mère : elle leur défend entr’eux toute union conjugale dans les degrés les plus rapprochés. Elle veut qu’ils ne puissent s’unir qu’à une distance où les liens du sang ne suffisant plus pour entretenir l’intimité fraternelle, il devient nécessaire de les retremper à une source commune. Sa conduite, digne de celui qui était venu pour consommer tous les hommes dans l’unité, se trouve résumée dans cet admirable passage de saint Augustin : “Au commencement du monde, dit le grand docteur, quand il n’existait qu’une seule famille, Adam et ses enfants, les hommes durent épouser leurs sœurs. Plus tard, le lien de parenté devint un obstacle dans l’opinion commune et dans les législations, parce qu’il sembla utile de multiplier autant que possible le nombre des liens d’affection entre les membres de la société humaine”.
Histoire de la Société Domestique, Abbé J. Gaume – 1854
________
Livre XV, Chapitre XVI
Différence entre la loi primitive
et la loi postérieure touchant le mariage
Le premier homme avait été formé du limon de la terre, et la première femme, tirée du côté de l’homme ; mais, pour croître et multiplier, ils durent suivre la loi naturelle de l’accouplement des sexes ; et, après ce premier mariage, la solitude de la terre rendit indispensables, entre frères et sœurs, des unions qui seraient maintenant des crimes énormes, à cause de la défense que la religion en a faite depuis. Cette défense est fondée sur une raison très-juste, sur une raison d’amour. Puisqu’il est nécessaire d’entretenir l’amitié et la société parmi les hommes, ce but est mieux atteint par des alliances entre étrangers qu’entre membres d’une même famille, qui sont déjà unis par les liens du sang. Père et beau-père sont des noms qui désignent deux alliances. Lors donc que ces qualités sont partagées entre différentes personnes, l’amitié s’étend et se multiplie davantage. Adam était obligé de les réunir en lui seul, parce que ses fils ne pouvaient épouser que leurs sœurs ; Ève de même était à la fois la mère et la belle-mère de ses enfants, comme les femmes de ses fils étaient ensemble ses filles et ses brus. Mais le besoin de multiplier les liens sociaux n’avait pas lieu alors qu’il n’y avait encore sur la terre que les frères et sœurs nés de nos premiers parents. Ce ne fut qu’à l’époque où un homme pouvait épouser une femme qui n’était pas sa sœur ; et ces mariages entre frères et sœurs non seulement n’étaient plus nécessaires, mais étaient même réprouvés comme abominables. En effet, si les fils de la seconde génération, qui avaient à leur disposition des cousines, eussent pris leurs sœurs pour épouses, ils auraient réuni, non plus deux, mais trois alliances en une seule personne, et auraient nui par là à l’extension de la charité. Un seul homme eût été à la fois père, beau-père et oncle, et une seule femme eût été de même mère, tante et belle-mère ; la même accumulation de qualités contraires aurait eu lieu dans la personne des enfants : mais, au contraire, en se disséminant et en s’éloignant de leur source, ces qualités devaient contribuer à multiplier parmi les hommes les liens de la charité.
Depuis que les hommes se sont multipliés, les choses ont bien changé sous ce rapport, même parmi les idolâtres : encore que ces alliances soient permises en certains pays, une plus louable coutume a proscrit cette licence, et nous en avons autant d’horreur que si cela ne s’était jamais pratiqué. Véritablement, la coutume fait une merveilleuse impression sur les esprits ; et comme elle sert ici à arrêter les excès de la convoitise, on ne saurait la violer sans crime. S’il est injuste de remuer les bornes des terres pour envahir l’héritage d’autrui, combien l’est-il plus de renverser celles des bonnes mœurs par des conjonctions illicites ? Nous avons éprouvé, même de notre temps, dans le mariage des cousins germains, combien il est rare que l’on suive la permission de la loi, lorsqu’elle est opposée à la coutume. Bien que ces mariages ne soient point défendus par la loi de Dieu, et que celles des hommes n’en eussent point encore parlé, toutefois on en avait horreur à cause de la proximité du degré : il semblait que ce fût presque faire avec une sœur ce que l’on aurait fait avec une cousine germaine. Aussi voyons-nous que les cousins et les cousines à ce degré s’appellent frères et sœurs. Il est vrai que les anciens patriarches ont eu grand soin de ne pas trop laisser éloigner la parenté, et de la rapprocher en quelque sorte par le lien du mariage ; de sorte qu’encore qu’ils n’épousassent pas leurs sœurs, ils épousaient toujours quelqu’une de leur famille. Mais qui peut douter qu’il ne soit plus honnête de nos jours de défendre le mariage entre cousins germains, non seulement pour les raisons que nous avons alléguées, afin de multiplier les alliances et n’en pas réunir plusieurs en une seule personne ; mais aussi parce qu’une certaine pudeur louable fait que nous avons naturellement honte de nous unir, même par mariage, aux personnes pour qui la parenté nous donne du respect ?
L’union de l’homme et de la femme est comme la pépinière des villes et des cités ; mais la cité de la terre se contente de la première naissance des hommes, au lieu que la cité du ciel en demande une seconde pour effacer la corruption de la première. Or l’Histoire sainte ne nous apprend pas si, avant le déluge, il y a eu quelque signe visible et corporel de cette régénération, comme fut depuis la circoncision imposée à Abraham. Elle rapporte toutefois que les premiers hommes ont fait des sacrifices à Dieu, comme cela se voit clairement par ceux de Caïn et d’Abel, et par celui de Noé au sortir de l’arche : et nous avons dit à ce sujet, dans les livres précédents, que les démons, qui veulent usurper la divinité et passer pour dieux, n’exigent des hommes ces sortes d’honneurs que parce qu’ils savent bien qu’ils ne sont dus qu’au vrai Dieu.
La Cité de Dieu (Livre XV, Chapitre XVI), Saint Augustin
________
Tout comme l’Hellénisme grec 1250 ans auparavant (625 A.C.), l’Islam arabe à sa naissance (625 P.C.) fonde la Cité Civilisée spiritualiste, directement à partir de la Commune primitive matérialiste.
On peut prendre la chose sur le fait avec l’exposé de Louis Milliot de 1953 que je reproduis.
J’ajouterai à cela deux observations :
Quand on parle des Noms de Dieu en Islam, ne jamais oublier que deux de ces Noms de premier rang, Miséricordieux-Vengeur, forment couple.
On a pris plus tard, par la force des choses, et parce que la religion est vivante, le nom de Miséricordieux au sens de “dieu d’Amour”. Ce n’est pas ainsi qu’il faut le lire dans le Coran.
Dieu Pardonneur (miséricordieux) est de façon toute “simple”, à l’origine, celui qui a le privilège de renoncer à la Vengeance, en même temps que celui qui a la prérogative suprême de l’exercer. C’est évidemment de cette manière que l’on doit et peut délivrer la vieille société parentale-ethnique de sa Coutume devenue oppressive et instaurer à sa place l’esprit du Droit. Il n’y a là rien d’incompréhensible et de choquant.
Ce genre de remarque est nécessité par l’honnêteté intellectuelle et la conformité historique. Loin de “rabaisser” la religion, c’est lui rendre toute sa fraîcheur, sa force et son audace ; c’est aussi commencer à y comprendre quelque chose.
La fondation et le perfectionnement de l’ordre Civilisé furent une tâche extrêmement difficile. La preuve en est qu’en 1923, Larousse disait encore ceci : L’esprit de vengeance, de la Vendetta (les Vendettes), s’est beaucoup adouci chez les Corses, “mais il y a toujours des BANDITS, c’est-à-dire des hommes qui, après la satisfaction d’une vendetta, ONT PRIS LE MAQUIS”.
Je joins un document décrivant où on en était dans l’Ile de Beauté à la veille de la Révolution, en 1771, au temps de la chute de Paoli et de la jeunesse de Bonaparte.
Extrait de Autour de l’Islam, Freddy Malot – 1999
________
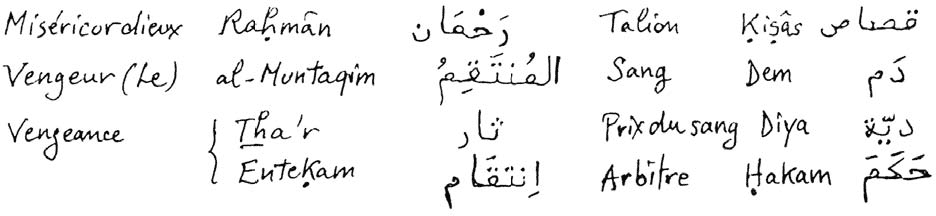
________
Dans l’Arabie primitive, on en est encore au stade de la justice privée et de l’arbitrage volontaire ; il n’y a pas d’organisation étatique. Il y a un chef, le shaikh ; mais si l’on met à part la conduite de la guerre, il a beaucoup plus de devoirs et de charges qu’il n’a de droits et de pouvoirs. Son rôle est surtout de tenir table ouverte pour les hôtes et de payer les compositions pour meurtre. La vengeance est, en effet, la grande loi en matière de meurtre ; c’est ce qu’on appelle le thâ’r.
L’homicide doit être vengé par le meurtre de l’agresseur lui-même, ou d’un ou plusieurs de ses contribules. Le vengeur est le maître du sang, le chargé du sang, le préposé au sang (walî-al-dam). Le thâ’r ainsi conçu est impersonnel, aussi bien au point de vue de l’agent qui l’exerce que du sujet sur lequel il s’exerce.
Au point de vue, d’abord, de l’agent qui exerce le thâ’r, c’est la tribu à laquelle appartient la victime qui est considérée comme atteinte, par application du principe de solidarité entre tous ses membres, solidarité nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’autorité centrale. Au point de vue du sujet sur lequel il s’exerce, le thâ’r est impersonnel, c’est-à-dire que le vengeur peut poursuivre sa vengeance sur une personne quelconque de la tribu du meurtrier. Le thâ’r est en outre illimité ; le préposé au sang peut abattre plusieurs têtes pour une seule. Le thâ’r revêt encore un caractère religieux ; l’âme de la victime demeure attachée à la terre tant qu’elle n’est pas vengée. Enfin, il n’y a pas de procédure régulière ; tous les moyens sont bons pour accomplir le thâ’r.
En réalité, la composition est courante ; il est très fréquent qu’on renonce à la vengeance en échange d’une indemnité fixée par la coutume et consistant en un certain nombre de chameaux. Alors naissent des contestations au sujet du quantum de la compensation, qui vont faire entrer en jeu l’institution de l’arbitrage. Très fréquentes sont, d’ailleurs, les contestations suivies d’arbitrage, car le champ d’application de la justice privée est restreint à l’homicide ; pour tout autre conflit, le règlement est du ressort d’un tiers, institué comme juge arbitre (hakam).
Il arrive que la composition soit forcée ; c’est le cas des lésions corporelles (coups et blessures). Alors l’arbitre n’intervient qu’en cas de litige au sujet du montant de la composition. Mais, le plus souvent, l’atteinte aux intérêts matériels ou à l’honneur fait directement intervenir la procédure d’arbitrage. Les atteintes à l’honneur résultent, notamment, des disputes au sujet de la prééminence nobiliaire : telle tribu prétend qu’elle a plus de noblesse, plus de quartiers d’ancienneté, plus de mérites que telle autre ; la controverse commence par une joute oratoire et se termine en querelle et rixe (nafra, munâfara). Si un arbitrage intervient, les parties ont, en principe, le libre choix de l’arbitre ; mais celui-ci doit réunir certaines qualités : honneur, droiture, prestige. Le hakam est un vieillard, un poète, un orateur renommé ou un savant. Il arrive qu’il soit l’évêque d’une tribu chrétienne. Le plus souvent, il est un kâhin, c’est-à-dire un devin, un diseur d’oracles qui s’en vient, juché sur un âne, procéder à un arbitrage qu’il est, bien entendu, libre de refuser.
Droit Musulman, Louis MILLIOT,
Professeur à la Faculté de Droit de Paris – 1953
La vengeance a toujours été, et malheureusement est encore leur vice le plus commun, et le trait distinctif de leur caractère ; elle y est poussée jusqu’aux plus horribles excès, et revêtue des circonstances les plus atroces. Le temps qui affaiblit tout, ne fait que fortifier leurs inimitiés domestiques. Elles s’étendent ordinairement jusqu’au quatrième degré de parenté ; on n’excepte que les prêtres, les femmes et les enfants. C’est à ce fléau qu’on doit attribuer la dépopulation de cette île, et à la mauvaise administration de plusieurs commissaires généraux, qui toléraient, laissaient impunis, et favorisaient quelquefois les assassinats. Ainsi les familles se détruisaient par cette fatale réciprocité d’engagement ; et d’ailleurs le premier assassin intéressé à continuer son crime pour la conservation de ses jours, multipliait les meurtres autant qu’il pouvait, et qu’il ne restât plus de vengeur au premier de ses ennemis, qui avait péri de ses mains. On a vu tuer un vieillard de quatre-vingts ans, qui était le dernier individu d’une famille nombreuse, éteinte entièrement par des assassinats, pour cause de vengeance.
Il n’est rien de si sacré, qui puisse retenir chez les Corses les mouvements de cette passion violente. Un habitant de Monte-Maggioré, assistant le jour d’une fête solennelle à la messe paroissiale du lieu, apprend au milieu des cérémonie augustes du sacrifice, qu’on vient de donner la mort à son cousin. Emporté par l’esprit de vengeance, il trouble tout-à-coup le silence des mystères, en s’écriant d’une voix menaçante, qu’on m’apporte mon fusils, la-mia scoppetta. Cette expression de sa colère dans le temple du Dieu de la paix et en présence de ses autels, était insolite et barbare : mais il faut remarquer que personne ne fut scandalisé de son emportement. Il sorti de l’Église, en continuant d’exhaler sa fureur, alla prendre ses armes, et battit la campagne pendant trois années, pour chercher le moment de satisfaire sa passion. Parmi les assassins qui sont poursuivis, les uns ne sortent que de nuit, ou de jour avec de grandes précautions ; d’autres restent cachés sous quelques maches, ou dans les antres de quelques rochers, où leurs parents qui savent leur retraite, ont soin de leur envoyer des provisions. Tandis que le vengeur était à la recherche du meurtrier, les deux familles s’accommodent ensemble, et nous allons voir dans cet incident un nouveau développement des mœurs de ce peuple.
Il y a en Corse des médiateurs entre les familles qui ont des inimitiés, comme il en est entre les puissances belligérantes qui sont en guerre. Ceux de Monte-Maggioré ménagèrent une pacification qui fut signée des parties intéressées, et même par le fils du défunt, âgé tout au plus de dix ans. Comme les Corses, dans le commerce de la vie civile, observent exactement leur parole, surtout lorsqu’elle est consignée dans un acte public, la paix eut été bien cimentée, sans une subtilité qui en renversa les fondements. Les parents du mort se ravisèrent, et trouvèrent que l’acte était illégal et nul, au moins à l’égard de l’enfant qui l’avait signé, et qui, à cause de son bas-âge, ne pouvait valablement coopérer à aucun contrat. Ils décidèrent qu’il n’était point tenu, comme les autres, à suivre l’engagement qu’on avait pris, et qu’il demeurait obligé de venger la mort de son père ; sa mère lui annonçait tous les jours qu’il le devait. Ces paroles souvent répétées, firent germer la haine dans son âme. À peine eut-il atteint sa quatorzième année, qu’il se mit en campagne, chercha son ennemi, le surprit et le tua.
Ce n’est pas le seul qui ait fait ainsi le premier essai de ses armes ; la même loi est imposée à tous ceux dont les pères ont été malheureusement assassinés. Il est arrivé que des femmes ayant trouvé la chemise ensanglantée de leur époux, l’ont gardée avec soin, pour l’offrir au premier regard de leurs enfants, et les exciter par ce spectacle à venger la mort de leur père. Elles leur marquaient elles-mêmes la victime qu’il fallait immoler, et rassuraient leur timidité contre l’horreur du crime, en les accoutumant à l’idée de l’assassinat. Il faut qu’elles fussent bien infectées de cette passion, puisqu’elles nourrissaient dans leur esprit ces projets sanguinaires ; puisqu’une mère, pour suivre l’esprit de vengeance, exposait souvent l’unique fruit de son amour, au ressentiment de toute une famille, et à une mort certaine. On assure que les femmes de cette espèce sont les premières à exciter leurs frères, leurs maris, et même leurs amants à ces sortes d’homicides ; qu’au risque de les perdre, elles les portent à les venger des moindres injures qu’elles ont reçues. Ayant accoutumé, pour les piquer d’honneur, de leur tenir ce discours en pareilles circonstances : “Vous ne méritez pas de porter le nom d’homme, si vous n’en tirez pas vengeance”. Cependant les querelles de femmes à femmes n’ont point ordinairement de suites fâcheuses ; elles se prennent de paroles, se chargent d’injures, en viennent quelquefois aux mains, et lorsqu’elles ont épuisé leur colère, elles se calment, et un moment après elles redeviennent amies ; mais il y a beaucoup de femmes estimables à l’abri de tout reproche.
Les inimitiés de ces peuples se produisent au dehors, surtout celle qui doit se terminer par une fin tragique, et qu’on appelle une inimitié de sang, una inimicitia di sangue. Autrefois le Corse possédé de cette passion, et qui méditait sa vengeance, laissait croître sa barbe d’une manière affreuse, principalement les montagnards, afin qu’en voyant ce symbole lugubre, on ne doutât point de son amour pour ses parents, s’il avait leur sang à venger, ni de sa bravoure, s’il devait tirer raison d’un affront insigne. Rien ne l’attendrissait dans cet été, ni la vue de son épouse, ni même celle de ses enfants. Il devenait rêveur, taciturne ; ses regards étaient farouches ; on était effrayé de son extérieur ; il prenait tous les sombres dehors de la tristesse, parce qu’il se croyait malheureux jusqu’à ce qu’il eût ôté la vie à son adversaire. Le Corse d’aujourd’hui qui nourrit un pareil projet de vengeance, est dominé d’une égale fureur, quoiqu’il ne porte point une longue barbe ; car ces vendettes ne subsistent plus ou sont bien rares. Il oublie son troupeau, et les besoins de sa famille, les grands intérêts de la patrie, ainsi que ceux de la liberté ne le touchent plus ; il cherche avec fureur les traces de l’infortuné qu’il veut perdre ; il grimpe les montagnes et pénètre la profondeur des forêts ; le jour finit ; mais sa colère ne se ralentit point. Il poursuit encore le lendemain son ennemi avec une ardeur égale à la haine qui le dévore. A-t-il découvert sa retraite, il respire ; mais il ne perd pas de temps, il s’embusque, il épie l’occasion favorable : il commence à jouir du plaisir de la vengeance. Enfin la victime de son ressentiment tombe dans ses pièges ; il l’immole, et sa rage satisfaite, il revient tranquillement au milieu de sa famille reprendre sans remords le cours de ses affaires et de ses anciennes habitudes. C’est le déni de justice, et l’impunité des assassinats qui ont rendu en ce pays la vengeance si commune et si sanguinaire.
La Corse néanmoins renferme des âmes généreuses qui savent maîtriser leur haine. Je n’omettrai point ici la belle action d’un habitant de Ziccavo, arrivée près de la fontaine du comté de Frasco, monument qui en perpétuera le souvenir. Ce citoyen vertueux se reposait avec trois des siens près de cette fontaine, lorsqu’il vit arriver inopinément dans le même lieu l’assassin d’un de ses fils, et qui n’était connu que de lui seul. Il lui parle avec amitié, le force de se rafraîchir avec eux, et de partager leur bonne chère. Cette invitation que le voyageur croit perfide, lui glace le sang dans les veines. Il s’y rend néanmoins, parce qu’il ne peut s’évader. Ils mangèrent tous deux dans des sentiments bien différents ; l’un consterné, croyait toucher au dernier moment de sa vie ; l’autre, qui se disposait à une action sublime, manifestait la joie que donne la pratique de la vertu. À la fin du repas, l’habitant de Ziccavo congédie sa compagnie, et demeure seul avec son ennemi. Votre vie, lui dit-il, est en mon pouvoir ; je pourrais vous l’ôter dans ce moment, et venger la mort de mon fils. Vous m’avez coûté bien des larmes ; vous avez mis la désolation dans ma famille ; mais je veux bien oublier tous les maux que vous m’avez causés ; souvenez-vous de traiter vos ennemis comme vous voyez que je vous traite, et persuadez-vous qu’il est plus glorieux et plus doux de pardonner, que de se venger. Après ces mots, il l’embrasse ; et le laissant dans l’admiration de ce qu’il venait de lui dire, il va rejoindre ses trois parents, et leur dit : “Cet homme que vous venez de voir, est le meurtrier de mon fils ! Je lui ai fait grâce, et lui ai conservé une vie qu’il ne tenait qu’à moi de lui arracher. Imitez mon exemple, et n’entreprenez jamais rien contre lui qui puisse altérer le plaisir que je ressens d’avoir fait une belle action”. Mais ces Insulaires sont, en général, si inflexibles dans leurs animosités, si obstinés dans leurs projets de vengeance, qu’il est passé en proverbe dans le pays même, qu’un Corse ne pardonne ni pendant sa vie, ni après sa mort. Il Corso non perdonna mai ne vivo ne morto.
M. l’Abbé de Germanes, 1771
________
________
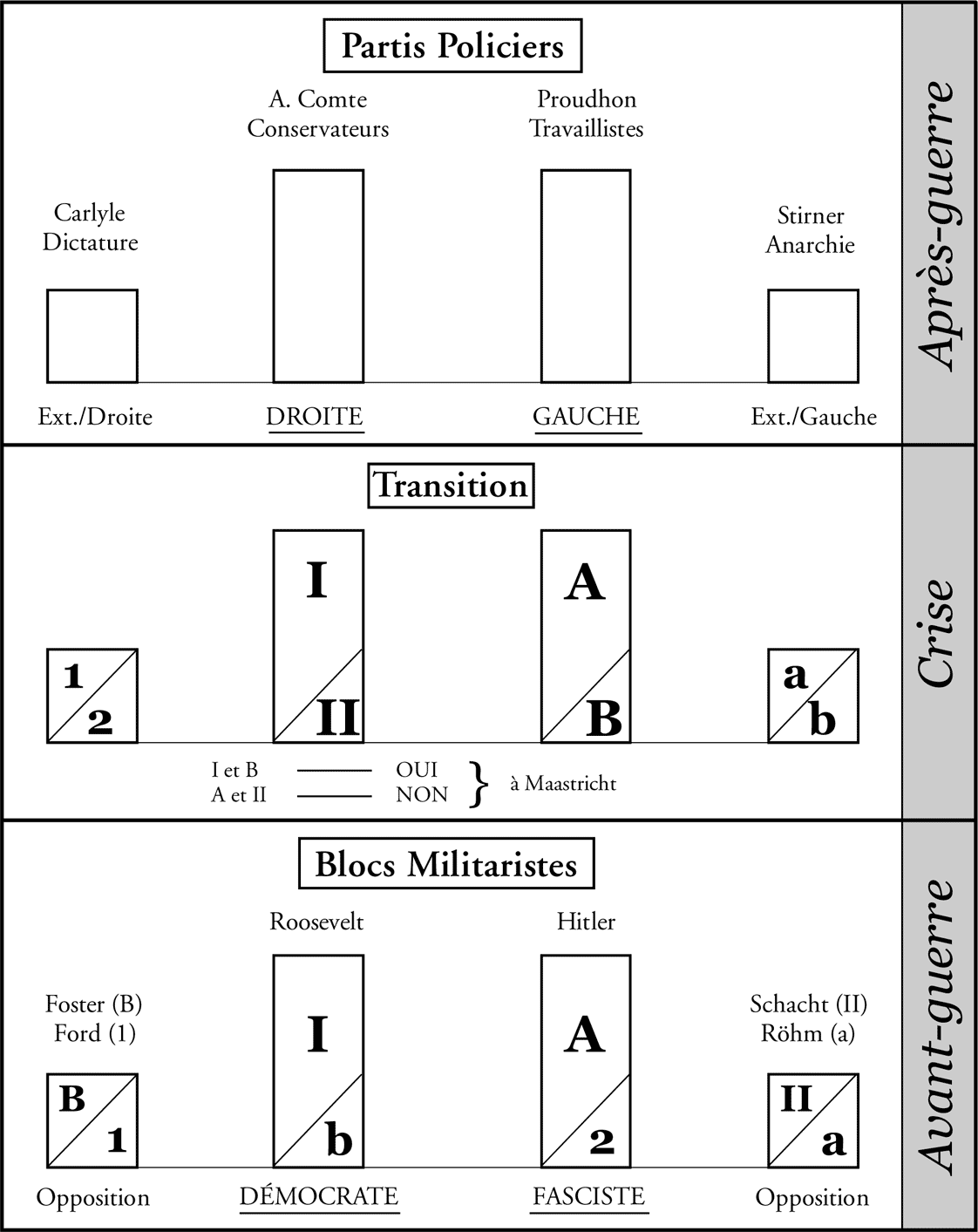
________
En 1845, tout est prêt, du côté de l’oligarchie financière, pour convertir la civilisation générale en Barbarie Intégrale dominante.
Depuis 1789, tout a été essayé en vain pour enrayer les conséquences populaires du parachèvement de l’ordre civilisé : Mirabeau, Roland, Barras, Fouché, tous ont été dépassés, balayés.
Et voilà qu’en 1830, le démon révolutionnaire de la Civilisation semble repartir, plus fou que jamais, totalement insatisfait de l’avènement du Roi Bourgeois, découvrant qu’un retour à 1790 ne répond plus du tout aux nécessités. Le soir des Trois Glorieuses, le grand cri est : “Révolution Escamotée” ! “Les Carbonari sont devenus tout à coup renégats, traîtres, transfuges et persécuteurs de leurs anciens amis” ! “Système d’aristocratie” ! “Gouvernement occulte” ! C’est ainsi qu’en juge le gentil Cabet… Les choses vont mal. Et voilà que les âmes vivantes se tournent vers le “prolétariat”, l’Utopisme socialiste et Communiste, avec Blanqui et Leroux sur le devant de la scène…
Ce n’est pas tout. 1840 amène la crise universelle et, avec elle, le mouvement inouï des Chartists anglais. En Angleterre ! Au pays de Pitt qui s’est préservé du Jacobinisme ! Au pays du Commerce et de l’Or ! L’affaire est gravissime. Ce n’est plus chez le Tsar, l’Empereur ou le Pape qu’il y a à craindre, nom d’une pipe ! Que faire ? D’autant qu’il ne s’agit plus de “théories” philanthropiques et de “conspirations” robespierristes ou bonapartistes ; c’est d’action populaire qu’il est question maintenant, comme il y a 50 ans, dans l’année de la Grande Peur...
Réponse de l’aristocratie financière : Alerte ! Ce n’est plus d’une question de dynastie, ou de forme de gouvernement, qu’il s’agit ; le problème est celui de Rome et des Barbares. Avec cette différence que les Barbares sont à l’intérieur ! Alerte ! C’est la Rome des Romes, la Rome de la Finance qui se trouve assaillie. C’est toute la civilisation qu’il nous faut revoir à la base, les 25 siècles écoulés qui ont malheureusement rendu le peuple majeur. C’est une Révolution Intégrale qui nous menace. Eh bien ! la seule riposte se trouve dans la Réaction Intégrale.
D’abord et avant tout, le mot d’ordre doit être : “Guerre à la Métaphysique” ! Soyons “Positifs” ! La Religion, c’était la Révolution, c’était la subversion incessante du monde, sous prétexte que l’ici-bas imparfait ne s’ordonnait pas à l’au-delà parfait et, en conséquence, qu’il “valait mieux obéir à Dieu qu’aux Hommes”. À la Religion Intégrale de Kant, dont s’est nourri le Panthéisme des Utopistes, opposons le Paganisme Intégral ; opposons aux visionnaires Réalistes et Nominalistes, la Laïcité Cléricale et Libre-Penseuse. Ce ne sera pas facile, certes, mais la mitraille et la subornation de quelques chefs aidant, c’est tout à fait jouable. Telle est donc la seule idéologie susceptible d’affronter l’après-89, qui tire toutes les leçons de 50 ans de désordres à répétition, et qui, du même coup, opérera à coup sûr le front uni derrière elle des réactions inconséquentes survivantes des derniers 25 siècles.
Mais l’idéologie du Paganisme Intégral qu’il nous faut, une fois mise au point, ce qui compte ensuite est de passer aux actes en profondeur. D’où le second mot d’ordre : donnons nous une “société normale”. L’idéologie “positive” n’a pas d’autre objet, ne perdons pas cela de vue : la société “normale”. La société normale est celle qui convient à la “nature humaine”, et pourtant la civilisation ne l’a jamais véritablement connue ; elle ne s’y trouvait qu’en puissance, ou ne l’ébauchait passagèrement qu’aux heures de Barbarie inconséquente, rapidement effacées par une promotion de l’esprit civilisé révolutionnaire. À présent, la tâche s’impose et le principe directeur peut enfin en être posé. Ce principe est le suivant : proclamation solennelle des Devoirs de l’Homme. Ceci est un impératif que nous dictent tous les acquis de la science Physique, lesquels se résument en une phrase : les hommes sont des animaux dont l’instinct social se trouve constamment dévoyé du fait de la malédiction de la Raison qui marque notre espèce. La sociabilité animale souffre donc d’une tare originelle, relativement aux abeilles et aux castors, qu’il nous faut à présent regarder en face. Ceci amène, simultanément à reconnaître que l’état normal, la société des devoirs de l’homme, ne peut être qu’un but que nous aurons à poursuivre indéfiniment, puisque la sociabilité humaine ne peut parvenir à être programmée à la façon de celle des bêtes.
Grâce à l’esprit positif, lui même jailli au temps marqué où le défi des Barbares de l’intérieur nous est lancé, nous y voyons plus clair sur nos défaillances antérieures. Ainsi, Boissy d’Anglas, en 1795, quand il proclama la Constitution de l’An III, pour mettre un terme à la subversion civilisée, est excusable d’avoir alors faibli, de n’être pas allé au-delà d’une Déclaration des Devoirs ET DES DROITS de l’Homme. Notre caste de ploutocrates était encore fragile à l’époque, les esprits populaires étaient échauffés par les slogans de Rousseau, et les Ci-devants rameutés par la chute de Robespierre manifestaient des exigences déraisonnables. D’ailleurs, à ce moment, les Utopistes Babeuf et Godwin ne bénéficiaient que d’une audience très restreinte.
Aujourd’hui, il en va autrement : le communisme civilisé frappe désormais immédiatement à la porte de la préhistoire humaine. Manifestons donc de la façon la plus ferme et impitoyable qu’il ne peut et ne pourra jamais en être question. Avec Dieu détrôné, que l’on sache clairement que le Diable est aux commandes sociales. Nous veillerons à “durer” par tous les moyens. Que la masse populaire soit bien persuadée que nous sommes résolus à entraîner l’humanité entière à la mort si notre domination arrivait à être réellement mise en péril.
La bouillie barbare que nous venons de résumer forme le menu social qui nous est servi depuis 150 ans. Peu après 1845, Napoléon III, le Hitler gaulois, n’oublia pas la leçon. Lui aussi comprit qu’en matière de réaction sociale, rien ne pouvait marcher sans se présenter sous un habit “moderne”, sans tricher honteusement avec 1789, sans s’afficher dans une livrée “rationnelle”, “démocratique” et “scientifique”. À l’époque de Boissy d’Anglas, l’Anglais Burke qu’on nous réédite bruyamment en ce moment, avait indiqué également la voie.
Ce sont Auguste Comte et Pierre-Joseph Proudhon qui ont rédigé la charte de la Barbarie Intégrale :
- 1843, “Création de l’Ordre dans l’Humanité” – Proudhon ;
- 1844, “Discours sur l’esprit positif’” – Comte.
•••
Nos deux apôtres du satanisme ont en commun de poser la société comme un “organisme”, c’est-à-dire de faire dégénérer la vieille idée spiritualiste de la “nature humaine”, en présentant l’Homme toujours immuable, mais cette fois en tant qu’Animal handicapé par la Raison. Et voilà le type d’Intellectuels dont l’Occident et le monde vont avoir à subir les enseignements ! Cela dure depuis 150 ans, sans rien en changer de fondamental, en n’y apprêtant la chose qu’à des sauces les plus variées ; la seule différence qu’on peut noter, c’est une aggravation délirante du premier message, tout en recourant à une hypocrisie toujours plus accentuée.
Ce qu’il faut souligner cependant, c’est que, depuis l’origine, nous avons deux Animalités humaines rivales, bien que se réclamant également de la “science”, sous les étendards respectifs de Comte et Proudhon. Il importe d’éclairer rapidement cette dualité dans la doctrine des Devoirs de l’Homme.
• Le mot d’ordre de Comte est “Ordre et Progrès”. Il est entendu, bien sûr, qu’on aura le Progrès par l’Ordre et l’Ordre signifie explicitement l’organisation d’une nouvelle Hiérarchie sociale comme préalable à tout, la Répression devant y prêter la main si nécessaire. C’est ce que les positivistes nomment la “sociocratie”. Ainsi, les comtistes prônent une animalité humaine “objectiviste”, perversion de la théorie de Bentham de “l’Intérêt général”. Mais dans leurs harangues d’estrade, ils prennent soin de broder exclusivement sur le thème démagogique du Progrès ; on crée même une presse qui porte ce titre, comme à Lyon.
• Le mot d’ordre de Proudhon est “Égalité et Justice”. Il est entendu, bien sûr, qu’on aura la Justice par l’Égalité ; et l’Égalité signifie explicitement la Servilité organisée comme préalable à tout, la Corruption devant y prêter la main si nécessaire. C’est ce que les Proudhoniens nomment le “mutuellisme”. Ainsi, la faune proudhonienne prône-t-elle une animalité humaine “subjectiviste”, perversion de la théorie de Rousseau de “la Volonté générale”. Mais dans leurs harangues d’estaminet, ils prennent soin de broder exclusivement sur le thème démagogique de la Justice.
Le grand essor du tandem barbare fut le second Empire. On ne fut pas long à déceler que Comte travaillait pour Badinguet (Napoléon III) et Proudhon pour Plonplon (le Prince Jérôme, que les gogos nommaient “le prince rouge”). Mais en jetant les bases de la Barbarie Intégrale, Comte et Proudhon ne se trouvaient pas limités par le régime en place et se montrèrent capables de tous les rétablissements possibles. En effet, tous nos régimes y ont puisé ; non seulement la grande lignée Cavaignac, Jules Favre-Gambetta-Ferry-Jaurès-Blum-Thorez, mais tout aussi bien Pétain et De Gaulle ! Nous avons donc bien deux “maîtres” absolument incontournables.
Une chose à savoir : nos deux pasteurs de l’animalité humaine, partis ensemble d’abord en guerre contre l’Utopisme socialiste et communiste, ne se sont pas gênés pour rapidement s’afficher comme les plus résolus partisans du “socialisme”, le “vrai” socialisme bien entendu ! De la même manière, ils ne cessèrent d’avoir à la bouche la défense des intérêts du “Prolétaire” et de la “Femme”, de la “Paix”… et de tout ce qu’on voudra !
•••
Que signifie, pratiquement, l’émulation acide entre organicistes objectivistes de l’École Comte et organicisme subjectiviste de l’École de Proudhon ? C’est assez simple :
• Comte est la “droite” du parti barbare et le bras “politique”.
• Proudhon est la “gauche” du parti barbare et le bras “syndical”.
Concernant le Paganisme Intégral dans sa version Laïque, Comte représente le parti Clérical, et Proudhon le parti Libre-Penseur [2].
Tout cela forme un ensemble “cohérent” à sa manière, même si cela ne va pas sans grincements entre les deux cliques :
• D’abord, comment faire, en général, pour qu’une oligarchie barbare soit unie ? Ce serait miracle !
• Ensuite, alors que les syndicaux proudhoniens forment toujours nécessairement la base du système, il est inévitable que les politiques comtistes tirent, finalement et en “temps normal”, les marrons du feu, en même temps que la Chambre des Députés joue évidemment le rôle de “sénat conservateur” vis-à-vis des Organisations Ouvrières (!)… jaunes ! Tout cela crée des tas de rancœurs, sans que rien ne compromette le moins du monde “l’union sacrée” quand il s’agit des “intérêts supérieurs de l’État”, ni les rituelles “alternances Droite-Gauche” que l’on connaît. Au hasard, citons les “empoignades” pour rire, type Bloc National de Poincaré contre Cartel des Gauches d’Édouard Herriot en 1925.
• Enfin, il y a quelque chose de plus subtil à assimiler. C’est que tout le cinéma Droite-Gauche des après-guerre se trouve totalement remanié dans les avant-guerre, où le ronron intérieur passe au second plan, mettant d’actualité de vastes alliances à but géopolitique, dans les camps respectifs Démocrate et Fasciste. Le type le plus récent est le face-à-face Roosevelt-Hitler. Précisons avant tout qu’il serait complètement erroné de croire que ces gens vont réellement se battre eux-mêmes militairement, pas plus qu’ils ne se ruinaient économiquement en temps de “paix”. Alors, au contraire, c’est le Peuple mondial seul à qui on va offrir l’occasion de s’entre-tuer. La chose essentielle à saisir, surprenante au premier abord, et qu’on a pourtant devant notre nez sans la voir, c’est qu’alors, les méchants fascistes ont leur camp impulsé par l’aile marchante de l’ancienne Gauche. Réciproquement, l’armature du camp Démocrate rival est constituée par une troupe venant de l’ancienne Droite. Qui ne veut pas s’incliner devant ce fait s’obstine à ne tirer aucune leçon de l’histoire des 150 dernières années.
En tout cas, il nous faut nous défaire des légendes absurdes, qui font de Proudhon le “père de l’Anarchie”, et d’Auguste Comte le père du “parti du Mouvement”, c’est-à-dire de la Gauche. De telles niaiseries ne peuvent avoir cours que dans les pays Latins ou plus arriérés encore, où les esprits sont embourbés dans les débats archi-usés sur le curé et l’instituteur, Pépone et Dom Camillo…
•••
En vue d’un approfondissement philosophique ultérieur, je présente dès à présent un tableau schématique donnant les caractéristiques des deux cliques fondatrices de la Barbarie Intégrale :
|
ORGANISCISME |
|
|
COMTE (Objectiviste) • Mathématique “concrète” (L’Unité arithmétique discrète est posée congénère du continu). • Astronomie “morale”. • Probabilisme. |
PROUDHON (Subjectiviste) • Logique “sérielle” (L’Identité exclusive est posée congénère de l’altérité). • Chimie “morale”. • Relativisme. |
Je demande de bien observer et vérifier que chacun des compères, en prétendant absorber la Morale dans la Physique, engendre en retour une physique décidément convulsionnaire.
•••
Sans l’exposé qui précède, il eut été difficile de tirer parti des morceaux choisis de Comte et Proudhon que je fais suivre, se rapportant à leur politique du Ménage et de la Femme.
Remarquons que Larousse, exposant “l’utopie” de Comte sur la Vierge-Mère, s’exprime non seulement après la rupture entre Comte et Littré, mais 25 ans après Comte ; et que Comte écrivait dans le feu de l’après 1848-49, alors que Larousse déballe sa pisse d’âne dans l’immédiat après-guerre et la jubilation vulgaire qui accompagne l’adoption des Lois Constitutionnelles de la grandiose 3ème République barbare.
Ainsi on peut comprendre que le plan sadique d’institution de la Vierge-Mère sorti de la plume du clérical Auguste Comte, n’entra en application que sous le “socialisme national” d’Hitler, fondamentalement animé par la Libre-Pensée de Proudhon (Ordre Masculin, nommé Der Männerbund ; “mariages biologiques”, etc.).
Freddy Malot – mars 1999
________
extrait du Grand Dictionnaire Pierre Larousse – 1876
Utopie positiviste de la Vierge mère
(Cf. A. Comte, “Politique”, IV, 1851-1854)
C’est une conception que le fondateur de la philosophie positive a proposée à ses disciples comme le type des utopies. C’est le dernier mot du progrès humain, entendu à la façon d’Auguste Comte. C’est le résumé synthétique et le postulatum final de la religion de l’humanité. Comte déclare que l’utopie de la Vierge mère “est destinée à résumer l’ensemble de notre perfectionnement physique, intellectuel et moral en le concentrant sur un progrès décisif.” En quoi consiste ce progrès ? Il consiste “à systématiser la procréation humaine en la rendant exclusivement féminine.” Ce progrès, comme la transmutation des métaux au moyen âge, fournit un objet et un point de “ralliement admirable”, aux vœux et aux efforts théoriques et pratiques. Il procure à l’essor utopique “une destination sociale” en l’étendant à l’ordre humain. Il vient éliminer et remplacer “les utopies perturbatrices” de la théologie et de la métaphysique. Il représente, ce qu’on on ne pourrait attendre d’aucune autre utopie, “l’universelle prépondérance de la morale.”
Voici comment Auguste Comte explique et légitime son utopie ou, comme il dit, son institution de la Vierge mère :
“En surmontant les préjugés scientifiques, on doit d’abord reconnaître l’harmonie continue d’une telle institution avec l’ensemble des lois réelles. Restreinte à l’espèce la plus modifiable et propre au sexe le mieux perfectible, elle y conserve la plus éminente des fonctions végétatives, celle où le cerveau peut davantage modifier le corps. La rationalité du problème est fondée sur la détermination du véritable office de l’appareil masculin, destiné surtout à fournir au sang un fluide excitateur, capable de fortifier toutes les opérations vitales, tant animales qu’organiques. Comparativement à ce service général, la stimulation fécondante devient un cas particulier, de plus en plus secondaire à mesure que l’organisme s’élève. On conçoit ainsi que, chez la plus noble espèce, ce liquide cesse d’être indispensable à l’éveil du germe, qui pourrait artificiellement résulter de plusieurs autres sources, même matérielles, et surtout d’une réaction du système nerveux sur le système vasculaire. Un tel perfectionnement se trouve annoncé par l’essor croissant de la chasteté, qui, propre à la race humaine, du moins parmi les mâles, y montre l’efficacité physique, intellectuelle et morale d’un bon emploi du fluide vivifiant. Mais cette indication se développe surtout chez la femme, vu le cours continu de trois symptômes spéciaux : la minime participation de ce liquide à la fécondation, l’établissement du flux mensuel et l’influence de la mère sur le fœtus.
Cette induction objective peut être subjectivement fortifiée d’après le cours général des opinions relatives à la procréation humaine. En effet, ce résultat se trouve rapporté de plus en plus à l’ascendant féminin. Or, une telle progression ne tend pas seulement à faciliter et à manifester l’avènement de l’utopie qui la compléterait. Pour quiconque a bien apprécié l’harmonie générale entre le subjectif et l’objectif, cette marche des conceptions peut aussi représenter le cours des phénomènes, dans un ordre très modifiable, dont les pas antérieurs nous sont inconnus, faute d’une théorie de l’hérédité. Dés lors on conçoit que la civilisation, non seulement dispose l’homme à mieux apprécier la femme, mais augmente la participation de ce sexe à la reproduction humaine, qui doit, à la limite, émaner uniquement de lui.”
Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le positivisme comtiste, avec son utopie de la Vierge mère, se met en contradiction flagrante avec l’esprit expérimental et positif de la science moderne ; qu’il reprend, à la suite des vieux mysticismes, le chemin des croyances arbitraires et des folles imaginations ; que cette chimère de la procréation exclusivement féminine ne peut se fonder sur aucune donnée, ni même sur aucune induction biologique un peu sérieuse ; qu’aucun physiologiste sérieux ne saurait admettre “la minime participation du fluide séminal à la fécondation dans l’espèce humaine” ; ni assigner pour “véritable office à l’appareil masculin de fournir au sang un fluide excitateur qui fortifie toutes les opérations vitales tant animales qu’organiques ;” ni soutenir “que la civilisation a augmenté la participation du sexe féminin à la reproduction humaine.”
Après avoir essayé de légitimer scientifiquement son utopie de la Vierge mère, Auguste Comte en expose les avantages et la portée sous le rapport moral et social.
“Personnellement envisagée, une telle modification doit améliorer la constitution cérébrale et corporelle des deux sexes, en y développant la chasteté continue, dont l’importance fut de plus en plus pressentie par instinct universel, même pendant les dérèglements. Cette conséquence résultera, chez la femme, de la faible énergie des appétits charnels, dont l’excitation repose ordinairement sur le besoin de devenir mère. Quant à l’homme, où les dispositions sont inverses, tout prétexte d’abus sexuel ayant ainsi disparu, l’éducation et l’opinion feront aisément prévaloir le besoin de conserver le fluide vivifiant pour sa destination normale, alors plus développée et mieux appréciée.
Domestiquement considérée, cette transformation rendrait la constitution de la famille humaine plus conforme à l’esprit général de la sociocratie, en complétant la juste émancipation de la femme, ainsi devenue indépendante de l’homme, même physiquement. L’ascendant normal du sexe effectif ne serait plus contestable envers des enfants exclusivement émanés de lui. Mais le principal résultat consisterait à perfectionner l’institution fondamentale du mariage, dont la théorie positive deviendrait alors irrécusable. Ainsi purifié, le lien conjugal éprouverait une amélioration aussi prononcée que quand la monogamie y remplaça la polygamie, car on y réaliserait l’utopie du moyen âge où la maternité se concilie avec la virginité. Ce plein essor du principal mérite de la femme resterait d’ailleurs conciliable avec la réaction sympathique de l’instinct sexuel, d’autant mieux assurée que la satisfaction est plus restreinte, sans interdire une volupté dont la dignité cesse après la concession initiale.
Appréciée civiquement, cette institution permet seule de régler la plus importante des productions, qui ne saurait devenir assez systématisable tant qu’elle s’accomplira dans le délire et sans responsabilité. Réservée à ses meilleurs organes, cette fonction perfectionnerait la race humaine en déterminant mieux la transmission héréditaire des améliorations dues à l’ensemble des influences continues, tant sociales que personnelles. Les principales lois de ce grand phénomène resteront probablement inconnues jusqu’à ce que son accomplissement se trouve ainsi simplifié. Mais la procréation systématique devant toujours demeurer plus ou moins concentrée chez les meilleurs types, la comparaison des deux cas susciterait, outre de précieuses lumières, une importante institution qui procurerait à la sociocratie le principal avantage de la théocratie. Car le développement du nouveau mode ferait bientôt surgir une caste sans hérédité, mieux adaptée que la population vulgaire au recrutement des chefs spirituels et même temporels, dont l’autorité reposerait alors sur une origine vraiment supérieure, qui ne fuirait pas l’examen.”
Ainsi, le grand avantage social de l’utopie réalisée de la Vierge mère serait de fournir une caste sans hérédité, une noblesse où se recruteraient les chefs spirituels et temporels, c’est-à-dire de rétablir l’autorité, le droit de la naissance sur des bases nouvelles, cette fois réelles et scientifiques ! En ce trait curieux se montre le caractère rétrograde, autoritaire, antijuridique, antiégalitaire du positivisme comtiste. Ajoutons que l’émancipation physiologique de la femme que rêve A. Comte, si elle devenait possible, ce qu’il est absurde d’admettre un seul instant, au lieu de constituer un progrès pour le mariage, tendrait plutôt à le détruire, en lui ôtant le fondement solide de la responsabilité paternelle. Mais à quoi bon insister sur les points faibles d’une utopie que beaucoup de nos lecteurs trouveront ridicule, et que nous n’avons exposée ici que pour signaler un curieux exemple des erreurs où peut se laisser entraîner un grand esprit qui s’isole et qui veut se poser en réformateur universel ?
Grand Dictionnaire Pierre Larousse – 1876
________
La méthode Positive en seize leçons
Condensée par J.-Émile Rigolage – 1917
Nous allons apprécier maintenant les conditions d’existence sociale relatives à la famille.
Tout système devant être formé d’éléments homogènes, l’esprit scientifique ne permet pas de regarder la société comme composée d’individus. L’unité sociale consiste dans la famille, au moins réduite au couple qui en constitue la base. La famille présente le germe des dispositions de l’organisme social ; elle constitue un intermédiaire entre l’individu et l’espèce. C’est par là que l’homme commence à sortir de sa personnalité et apprend à vivre en autrui.
La constitution de la famille, loin d’être invariable, reçoit des modifications plus ou moins profondes, dont l’ensemble offre, à chaque époque, la mesure du changement opéré dans la société correspondante. La famille ancienne, dont certaines catégories d’esclaves faisaient partie, différait de la famille moderne. Nous devons considérer la famille en ce qu’elle offre de commun à tous les cas sociaux, en regardant la vie domestique comme la base de la vie sociale. À ce point de vue, la théorie sociologique de la famille peut être réduite à l’examen de deux ordres de relations : la subordination des sexes et celle des âges, dont l’une institue la famille, tandis que l’autre la maintient.
L’institution du mariage ne pouvait pas échapper à l’ébranlement révolutionnaire de toutes les autres notions sociales, après la décadence de la philosophie théologique, qui leur servait de base. Quand la philosophie positive pourra consolider la subordination des sexes, principe du mariage et de la famille, elle prendra son point de départ dans une exacte connaissance de la nature humaine, suivie d’une judicieuse appréciation de l’ensemble du développement social et de sa phase actuelle.
Sans doute l’institution du mariage est modifiée par le cours de l’évolution humaine. Le mariage catholique diffère du mariage romain, qui différait lui-même du mariage grec, et encore plus du mariage égyptien ou oriental, même depuis l’établissement de la monogamie. Les modifications de ce lien fondamental ne sont pas parvenues à leur dernier terme ; mais l’esprit absolu de la philosophie politique actuelle porte trop à confondre de simples modifications avec le bouleversement total de l’institution.
Nous sommes dans une situation morale analogue à celle des temps principaux de la philosophie grecque, où la tendance à la régénération chrétienne de la famille et de la société donnait déjà naissance, pendant ce long interrègne intellectuel, à des erreurs semblables, comme le témoigne la célèbre satire d’Aristophane, où le dévergondage actuel se trouve d’avance si rudement stigmatisé.
La sociologie interdit comme prématuré l’examen des modifications futures du mariage moderne, en vertu du principe qui oblige à procéder de l’ensemble aux détails. L’étude spéciale de ces modifications doit être subordonnée à la conception, encore plus ignorée, du système de la réorganisation sociale. Tout ce qu’on peut garantir, c’est que, quelque profonds qu’on puisse supposer ces changements, ils resteront conformes à l’esprit de l’institution. Cet esprit consiste dans la subordination de la femme à l’homme, dont tous les âges reproduisent le caractère, et que la nouvelle philosophie politique préservera de toute tentative anarchique en lui ôtant le caractère religieux, pour la rattacher à la base fournie par la connaissance de l’organisme individuel et de l’organisme social.
La philosophie biologique commence à faire justice des déclamations sur la prétendue égalité des deux sexes en démontrant, par l’examen anatomique et par l’observation physiologique, les différences physiques et morales qui existent dans toutes les espèces animales, et surtout dans la race humaine. La biologie positive tend à représenter le sexe féminin, principalement dans notre espèce, comme constitué, comparativement à l’autre, en une sorte d’état d’enfance qui l’éloigne du type idéal de la race. Complétant cette appréciation scientifique, la sociologie montrera l’incompatibilité de toute existence sociale avec une chimérique égalité des sexes, en caractérisant les fonctions que chacun d’eux doit remplir dans la famille.
Les considérations indiquées dans l’examen sociologique de la constitution de l’homme permettraient d’ébaucher une telle opération philosophique. Les deux parties de cet examen font ressortir en principe, l’une, l’infériorité fondamentale, et l’autre, la supériorité secondaire de l’organisme féminin au point de vue social.
La prépondérance des facultés affectives est moins prononcée chez l’homme que chez tout autre animal, et un degré spontané d’activité spéculative constitue le principal attribut cérébral de l’humanité, ainsi que la source du caractère de l’organisme social. On ne peut contester, à cet égard, l’infériorité de la femme. Elle est plus impropre que l’homme à la continuité et à l’intensité du travail mental, en vertu de la moindre force intrinsèque de son intelligence, ou de sa plus vive susceptibilité morale et physique.
L’expérience a toujours confirmé, même dans les beaux arts, l’infériorité du genre féminin, malgré les qualités qui distinguent ordinairement ses spirituelles et gracieuses compositions. Quant aux fonctions de gouvernement, fussent-elles réduites à l’état le plus élémentaire et relatives à la conduite de la famille, l’inaptitude du sexe féminin est encore plus prononcée, parce que la nature du travail y exige une attention à un ensemble de relations plus compliquées, dont aucune partie ne doit être négligée, et une plus grande indépendance de l’esprit à l’égard des passions, en un mot, plus de raison. Sous ce premier aspect, l’économie de la famille humaine ne saurait être intervertie, à moins de supposer une chimérique transformation de notre organisme cérébral.
En second lieu, nous avons reconnu que les instincts personnels dominent les instincts sympathiques ou sociaux. C’est par l’examen de cette relation, si importante quoique secondaire, qu’on peut apprécier l’heureuse destination sociale du sexe féminin. Les femmes sont, en général, aussi supérieures aux hommes, par un plus grand développement de la sympathie et de la sociabilité, qu’elles leur sont inférieures par l’intelligence et par la raison. Leur fonction dans la famille, et par suite dans la société, doit être de modifier, par une plus énergique et plus touchante excitation de l’instinct social, la direction de la raison trop froide ou trop grossière de l’homme.
Considérons l’autre élément de la famille, c’est-à-dire la corrélation entre les enfants et les parents, qui, généralisée ensuite dans la société, y produit, à un certain degré, la subordination des âges. Ici les erreurs issues de l’anarchie intellectuelle sont d’un autre genre. La discipline naturelle est, sous ce second aspect, trop irrésistible pour pouvoir être sérieusement contestée. Les champions des droits politiques de la femme ne se sont pas encore avisés de construire une doctrine analogue en faveur de l’enfance.
Tous les âges de la civilisation ont rendu hommage au type de la famille. Où pourrait-on trouver, au même degré, de la part de l’inférieur, une plus respectueuse obéissance, imposée sans avilissement, d’abord par la nécessité et ensuite par la reconnaissance ; et chez le supérieur, une autorité plus absolue, unie à un plus entier dévouement ?
La vie de famille restera l’école de la vie sociale, soit pour l’obéissance, soit pour le commandement, qui doivent, en tout autre cas, se rapprocher autant que possible d’un pareil modèle. L’avenir ne pourra que se conformer, comme le passé, à cette obligation en tenant compte des modifications que le cours de l’évolution déterminera dans la constitution domestique. À toutes les époques de décomposition, des sophistes, au lieu de proposer la famille pour modèle à la société, ont cru montrer un grand génie politique en s’efforçant de constituer la famille à l’image de la société, et d’une société alors fort mal ordonnée, en vertu même de l’état exceptionnel qui permettait de telles rêveries.
Pour compléter l’appréciation de la subordination domestique, il importe de remarquer la propriété qu’a la famille d’établir la première notion de la perpétuité sociale en rattachant l’avenir au passé. À quelque degré que puisse parvenir la progression sociale, il sera toujours important que l’homme ne se croie pas né d’hier, et que l’ensemble de ses institutions et de ses mœurs tende à lier, par un système de signes intellectuels et matériels, ses souvenirs du passé à ses espérances d’avenir. L’esprit révolutionnaire de notre temps devait produire, à cet égard, un ébranlement provisoire, sans lequel l’imagination aurait été trop entravée dans son élan vers la rénovation du système social ; l’extension de ce dédain passager du passé tend à altérer l’instinct de la sociabilité.
La méthode Positive en seize leçons, J.-Émile Rigolage – 1917
________
Collection des Grands Économistes
Publiée sous la direction de M. le Professeur L. Baudin
A- Le groupe familial
La famille, à vrai dire, n’est pas mise par Proudhon exactement sur le même plan que les autres groupes. Elle constitue, à ses yeux, et il rejoint ici une fois de plus A. Comte et Saint-Simon, la véritable unité sociale, beaucoup mieux que l’individu [3].
“L’homme et la femme forment, au moral comme au physique, un tout organique dont les parties sont complémentaires l’une de l’autre” [4], une seule personne en deux personnes, une seule âme douée de deux intelligences et de deux volontés. Il s’ensuit que l’union de l’homme et de la femme ne saurait former un groupe de contractants égaux et indépendants, unis par un contrat synallagmatique, comme les membres des groupes professionnels ou géographiques. Elle est organisée sur une base hiérarchique et non mutualiste par suite des différences d’aptitudes naturelles entre l’homme et la femme. Si la seconde l’emporte en beauté, en délicatesse, en tendresse, elle n’a ni la force, ni le génie de l’homme ; elle ne peut rivaliser avec lui dans l’ordre économique, philosophique ou juridique. “L’homme et la femme peuvent être équivalents devant l’absolu, ils ne sont point égaux, ils ne peuvent pas l’être, ni dans la famille, ni dans la cité” [5] et cette subordination, conforme à la nature des choses, de l’épouse à l’époux, est plus forte encore entre parents et enfants, et fonde la hiérarchie familiale.
L’homme est donc le chef naturel et le seul représentant du couple dans ses relations avec la société [6]. Ce sont ces chefs de famille, libres et égaux, qui formeront à leur tour les autres groupes.
Textes choisis
“…L’homme et la femme se sont vus : ils s’aiment. L’idéal les exalte et les enivre, leurs cœurs battent à l’unisson ; la justice vient de naître dans leur commune conscience. Toute la création, qui de la mousse au mammifère a préparé, par la distinction des sexes, l’ineffable mystère, applaudit au mariage.
Rendons-nous compte de ce pacte, le premier de ceux que l’homme aura à former, sans lequel les autres seraient comme de plein droit résiliés, et qui n’aura jamais son pareil.
Quel est ici l’apport des parties ? En autres termes, qu’est-ce qui fait la matière du contrat ? Ce ne sont pas les services : de l’homme à la femme l’échange de services se conçoit sans doute et peut exister ; de là le contrat de domesticité. Mais la servante n’est pas l’épouse, ceci n’a pas besoin de discussion. Le concubinat même et la maternité, joints au service du ménage, ne suffiraient pas à faire passer la femme du rang de domestique à celui de matrone ; tout cela peut se liquider en argent, tandis que les honoraires de l’épouse ne peuvent s’estimer ni en marchandise ni en espèces. Ce n’est pas, enfin, le plaisir non plus qui fait l’objet du mariage : nous l’avons prouvé à satiété par l’analyse de l’amour et de ses œuvres.
Le mariage est l’union de deux éléments hétérogènes, la puissance et la grâce : le premier représenté par l’homme, producteur, inventeur, savant, guerrier, administrateur, magistrat ; le second, représenté par la femme, dont la seule chose qu’on puisse dire est qu’elle est, par nature et destination, l’idéalité réalisée, vivante de tout ce dont l’homme possède en lui, à un degré supérieur, la faculté, dans les trois ordres du travail, du savoir et du droit. Voilà pourquoi la femme veut l’homme fort, vaillant, ingénieux : elle le méconnaît, s’il n’est que gentil et mignon ; pourquoi lui, de son côté, la veut belle, gracieuse, bien disante, discrète et chaste.
Quelle étincelle va jaillir de ce couple ?
C’est un principe fondamental en théologie, principe que nous avons fait nôtre par la manière dont nous avons rendu compte du progrès ou pour mieux dire de l’origine du péché, que l’homme ne fait rien sans le secours de la grâce, en langue philosophique, sans idéal ; que sans cette excitation puissante, il ne devient ni laborieux, ni intelligent, ni digne ; il croupit dans la fainéantise, l’imbécillité et l’abjection. La grâce, ou l’idéal, est l’aliment dont se nourrit le courage de l’homme, qui développe son génie, fortifie sa conscience. Par cette grâce divine il connaît la honte et le remords ; il se rend industrieux, philosophe, poète ; il devient un héros et un juste juge, il sort de l’animalité et s’élève au sublime.
Telle est donc la série d’idées qui a décidé la création de la femme et fixé son rôle.
Sans une faculté positive et prédominante de justice, point de société ; sans un sentiment profond de la dignité personnelle, point de justice ; sans idéal, point de dignité ; sans la femme et l’amour qu’elle inspire, point d’idéal : pour mieux dire, l’idéal reste impuissant ; la grâce est inefficace, elle avorte. Nous avons vu ce que serait la femme sans ce trésor de sentiment et d’idées que la puissance virile verse en son cœur, et que sa seule peine est d’idéaliser ; l’homme, à son tour, sans la grâce féminine, ne serait pas sorti de la brutalité du premier âge ; il violerait sa femelle, étoufferait ses petits, ferait la chasse à ses pareils pour les dévorer.
Il suit de là que l’union de l’homme et de la femme ne constitue pas un pacte synallagmatique, dans le sens et les conditions ordinaires du contrat de mutualité, un tel pacte supposant les contractants ou échangistes respectivement complets dans leur être, semblables dans leur constitution, éclairés d’ailleurs par la justice au nom de laquelle ils s’associent ou traitent de la permutation de leurs services et produits. L’homme et la femme forment, au moral comme au physique, un tout organique, dont les parties sont complémentaires l’une de l’autre ; c’est une personne composée de deux personnes, une âme douée de deux intelligences et de deux volontés. Et cet organisme a pour but de créer la justice en donnant l’impulsion à la conscience, et de rendre possible le perfectionnement de l’humanité par elle-même, c’est-à-dire la civilisation et toutes ses merveilles. Comment s’accomplit cette justification ? Par l’excitation de l’idéal, ce que les théologiens nomment grâce, les poètes amour. Voilà toute la théorie. L’âge des amours est l’époque de l’explosion du sentiment juridique. Sans doute, la beauté de la femme s’efface avec l’âge ; l’homme lui-même peu à peu obéit à d’autres influences ; mais une fois trempé par la justice il ne rétrograde plus ; et c’est un fait que la corruption des sociétés ne commence pas par les générations qui ont aimé, elle commence par celles qui n’ont pas aimé encore, ou chez qui la volupté a pris la place de l’amour. Otez à la jeunesse la pudeur et l’amour, donnez lui en échange la luxure ; elle perdra bientôt jusqu’au sens moral : ce sera une race, vouée à la servitude et à l’infamie.
Cependant, rapprochés par la grâce, la poésie et l’amour, l’homme et la femme n’en restent pas moins soumis aux conditions économiques de l’existence : il faut travailler, pourvoir, se diriger à travers les difficultés de la vie. Comment vont se régler les conditions de leur alliance, puisqu’en définitive il n’y a pas seulement entre eux pacte d’amour mais constitution de droit ?
L’homme et la femme s’épousent sous la promesse et la loi d’un dévouement réciproque absolu. L’époux se doit tout entier à son épouse ; l’épouse se doit tout entière à son époux, et telle est la nature de cette réciprocité qu’elle n’a pas pour objet un avantage positif, matériel, comme l’exige la loi de toute société civile ou commerciale : dans le mariage, les avantages matériels ne sont qu’un accessoire, je dirais presque un accident, dont le partage est loin de pouvoir être regardé par les époux comme une compensation de ce qu’ils se donnent. Pour prix des travaux, des combats, des meurtrissures que l’honneur de la communauté et la gloire de sa femme lui commandent, l’homme recueillera, quoi ? un sourire ; la femme, à son tour, pour prix de ses soins, de sa tendresse, de sa vertu, aura, quoi ? un baiser. Des deux parts, sacrifice complet de la personne, abnégation entière du moi, la mise en jeu de la vie et de l’être pour une récompense idéale : voilà le sacrement de justice, voilà le mariage.
L’homme et la femme sont-ils faits égaux par cette union ? En résultat, au point de vue de la dignité et de la félicité, dans le secret de la chambre nuptiale et dans leur for intérieur, oui ils sont égaux ; le mariage, fondé sur un dévouement réciproque, absolu, implique communauté de fortune et d’honneur. Devant la société et dans la pratique extérieure, dans tout ce qui concerne les travaux et la direction de la vie, l’administration et la défense de la république, cette égalité n’existe pas, ne peut pas exister. Pour mieux dire, la femme ne compte plus, elle est absorbée par son mari. Et pourquoi ? D’un côté, la femme ne peut soutenir, pour la puissance des facultés, la comparaison avec l’homme, ni dans l’ordre économique et industriel, ni dans l’ordre philosophique et littéraire, ni dans l’ordre juridique : or, ces trois ordres de manifestations, correspondant aux catégories de l’utile, du vrai et du juste, embrassent les trois quarts de la vie sociale. Sous ce rapport, la société, en refusant à la femme l’isonomie, ne lui fait aucun tort ; elle la traite selon ses aptitudes et prérogatives. Dans l’ordre politique et économique, la femme n’a véritablement rien à faire : son rôle ne commence qu’au delà ; Elle reprend, direz-vous, l’avantage par la grâce et la beauté, et par l’influence qui en résulte. – Oui, mais encore une fois cet avantage ce n’est pas à la société, militaire, industrielle, gouvernementale, philosophe, juridique, à en faire la compensation. L’État, ou la société, comme on voudra, ne connaît point, ne peut pas connaître des choses de l’idéal et de l’amour. C’est à l’époux, représentant de la société vis-à-vis de la femme, de rembourser son épouse : ce qu’il fera, mais hors du marché en une autre monnaie, qui est le sacrifice de tout lui-même, en autres termes, par l’amour conjugal. Sortez de ce système, vous changez l’ordre de la nature, vous rendez l’homme misérable, sans rendre la femme plus digne ni plus heureuse. L’égalité des droits civils et politiques supposant une assimilation des prérogatives de grâce dont la nature a doué la femme avec les facultés utilitaires de l’homme, il en résulterait que la femme, au lieu de s’élever par ce mercantilisme, serait dénaturée, avilie. Par l’idéalité de son être, la femme est, pour ainsi dire, hors de prix. Elle atteint plus haut que l’homme, mais à condition d’être portée par lui. Pour qu’elle conserve cette grâce inestimable, qui n’est pas en elle une faculté productrice, une valeur échangeable, mais une qualité transcendante, il faut qu’elle accepte la loi de la puissance maritale : l’égalité au for intérieur, la rendant à l’homme odieuse et laide, serait la dissolution du mariage, la mort de l’amour, la perte du genre humain.
Tel est le mariage théorique, mariage qui se réalise de point en point dans la collectivité sociale, par l’ensemble des rapports qui soutiennent entre eux les deux sexes, et compensation faite des anomalies de détail et des griefs individuels, mais dont on ne manquera pas de dire qu’il est encore, pour l’immense majorité des sujets de l’un et de l’autre sexe, une utopie. Ceci nous conduit à une nouvelle face de la question.
•••
La famille : deuxième degré de juridiction
Si, dit-on, l’hyménée, de même que l’amour, est un pur idéal ; si sa théorie, par sa sublimité même, reste inapplicable, ou du moins inappliquée dans la pratique quotidienne, ne serait-il pas plus simple, plus sûr, plus moral même, de laisser le vulgaire grossier à la liberté des unions naturelles ? Qu’il est rare que l’amour, tel que le rêvent le jeune homme et la jeune fille, préside au mariage ! Et que de vices, que de déceptions déshonorent cette union réputée sainte ! Du côté masculin, quelle brutalité, quelle paresse égoïste, quelle lâche tyrannie, que de crapule ! Dans la femme, que de légèreté, de folie, et parfois d’insolence ! Que d’ineptie et de bavardage ! Quelle mollesse, quelle ordure sous sa vaine coquetterie ! Qu’attendre donc, pour le mariage, de pareils sujets ? Qu’espérer, pour le progrès de la justice et des mœurs, de couples si misérables ?
L’objection est vieille ; c’est la même qui jadis suggéra l’idée de réserver à l’aristocratie le privilège du sacrement, pendant que la vile multitude était reléguée, avec les esclaves, dans la prostitution et le concubinat.
Ceux qui, n’osant dénigrer l’institution, en allèguent les risques et accusent d’indignité matrimoniale la multitude des époux, oublient que le mariage, nécessaire d’ailleurs à la société, indispensable aux enfants, est fait surtout pour ces âmes brutes que l’on en voudrait voir écarter. C’est ainsi que s’est faite la première civilisation : elle a débuté par l’abolition de la promiscuité et de l’amour passager ; et ce faible idéal, que présentent chez des natures sauvages l’amour et la femme, s’est trouvé subitement consolidé et accru par le mariage.
Si quelque chose peut, en effet, ranimer l’amour assouvi, relever la femme qui s’est donnée, recréer cette idéalité toujours prête à périr dans la possession, c’est la pensée, inhérente au sacrement, et qui s’empare de la conscience des époux, qu’entre eux il existe autre chose que de l’amour, quelque chose qui dépasse autant l’amour que celui-ci dépasse le rut des animaux. Ce quelque chose, nous le connaissons : c’est le culte que l’homme et la femme se rendent l’un à l’autre, culte qui, chez le premier, s’adresse à la grâce, à la pudeur et à la beauté, chez la seconde, à la puissance.
En deux mots, la même personne, homme ou femme, paraîtra toujours meilleure et plus belle à celle qu’il aime dans le mariage que hors du mariage : je plaindrais celui qui, après avoir lu tout ce qui précède en demanderait encore la raison.
Le mariage est si bien la loi de l’humanité, à tous les degrés de civilisation et dans toutes les conditions sociales, qu’à peine unis dans la justice, les époux, si barbares fussent-ils du reste, se trouvent capables de donner l’initiation juridique à d’autres êtres et de s’élever encore par cette initiation ; c’est ce qu’a prévu la nature, et l’expérience prouve tous les jours qu’elle ne s’est pas trompée.
L’humanité est soumise à la loi du renouvellement. À cette œuvre de reproduction les deux sexes concourent, l’homme en fournissant le germe, la femme en donnant à l’embryon le premier accroissement. Pourquoi ce partage ? Pourquoi la femme a-t-elle été chargée plutôt que l’homme des fonctions de la maternité ?
La physiologie en indique une première cause : le soin de la tendre enfance convient mieux au plus tendre, au plus sensible et au plus compatissant des conjoints. L’économie domestique fournit un nouveau motif : l’homme devant produire pour toute la famille, il importait de lui laisser l’entière liberté de ses mouvements. Mais la théorie du mariage nous donne la raison supérieure, à savoir : l’éducation des enfants.
Le nouvel individu ne peut pas rester dans une immoralité animique jusqu’à l’époque où il recevra par l’amour la révélation de la justice : l’ordre de la famille, la digné de l’enfance, exigent que cette jeune conscience sorte de l’inertie par une initiation préparatoire. Or, cette première initiation du droit et du devoir, c’est la mère qui, sous la sanction paternelle, la donne.
Ce que la femme, le sexe gracieux, reçoit par le mariage du sexe fort et qu’elle idéalise à mesure, elle l’enseigne à son enfant, elle devient à son tour, par l’amour maternel, éducatrice du nouvel homme ; le père, par son autorité, apparaît comme garant et gardien.
Otez le mariage, la mère reste avec tendresse, mais sans autorité, sans droit. D’elle à son fils, il n’y a plus de justice : il y a bâtardise, un premier pas en arrière, un retour à l’immoralité.
Tel est donc, selon l’ordre de la nature, le développement organique de la justice. L’appareil juridique existe, il fonctionne, mais son action ne dépasse pas la limite des époux, qui est celle de l’idéal. Par la génération, l’idée du droit prend un premier accroissement : d’abord, dans le cœur du père. La paternité est le moment décisif de la vie morale. C’est alors que l’homme s’assure dans sa dignité, conçoit la justice comme son vrai bien, comme sa gloire, le monument de son existence, l’héritage le plus précieux qu’il puisse laisser à ses enfants. Son nom, un nom sans tache, à faire passer comme un titre de noblesse à la postérité, tel est désormais la pensée qui remplit l’âme du père de famille.
Il y a dans l’amour un moment d’enthousiasme que ne connaissent ni le sensualiste voluptueux, ni l’amant platonique, c’est quand, après les premiers jours de bonheur, l’homme est saisi tout à coup, au sein des joies conjugales, de l’idée de paternité. Relisez dans Milton la prière d’Adam appelant la bénédiction du Ciel sur son premier engendré : les sens, l’idéal, l’amour, tout a disparu ; il n’est resté que la charité et la conscience, déesses des unions saintes et des conceptions immaculées. Toutes les nations ont consacré cette fête sublime de la paternité par une institution qu’une justice plus rigoureuse a dû plus tard abroger, la primogéniture.
L’enfant est donné, Parvulus natus est nobis ; c’est un présent des dieux, A-deo-datus, une incarnation de la divinité présente, Emmanuel. On le nourrit de lait et de miel jusqu’à ce qu’il apprenne à discerner le bien du mal : Butyrum et mel comedet, donec sciat eligere bonum et reprobare malum ; c’est la religion de la justice qui poursuit son développement. Comment, dans l’accomplissement de ce devoir sacré, l’homme ne sentirait-il pas sa noblesse ? Comment la femme ne deviendrait-elle pas splendide ?
De l’époux à l’épouse, la justice a établi déjà, sans préjudice pour l’amour, une certaine subordination ; du père et de la mère aux enfants, cette subordination augmente encore et fonde la hiérarchie familiale, mais pour s’affaiblir plus tard et se résoudre, après la mort des parents, dans l’égalité fraternelle. Cela veut dire que pendant le premier âge la justice est une foi et une religion, non une philosophie ou une comptabilité : aussi le respect de l’homme pour l’homme, dégagé maintenant des excitations de l’amour et de l’idéal, atteint son apogée dans le cœur des enfants sous le nom à jamais consacré de piété filiale. Père de famille, tu dois être un jour le premier et le meilleur ami de ton fils ; ne te hâte pas trop cependant, si tu ne veux courir le risque de son ingratitude. La plus sûre garantie que tu puisses te donner de l’amitié de ce fils, lorsqu’il sera devenu homme, c’est la prolongation de son respect.
Ainsi le mariage, par le rapport mystérieux de la force et de la beauté, forme une première juridiction ; la famille, par la communauté de conscience qui régit ses membres, par la similitude d’esprit et de caractère, par l’identité du sang, par l’unité d’action et d’intérêt, en forme une seconde : c’est un embryon de république où l’égalité commence à poindre sous l’autorité hiérarchique, mais viagère, de la mère et du père. Dans ce petit état, les droits et devoirs pour chacun se déduiront de la théorie du pacte conjugal : pas n’est besoin d’en rapporter les formules.
Le dernier mot de cette constitution, moitié physiologique, moitié morale, est l’hérédité : n’est-ce pas une honte pour notre 19ème siècle qu’il faille encore la défendre ? L’humanité, qui se renouvelle continuellement dans ses individus, est immuable dans sa collectivité, dont chaque famille est une image. Qu’importe alors que le gérant responsable change, si le vrai propriétaire et usufruitier, si la famille est perpétuelle ? Bien loin de restreindre la successibilité, je voudrais, en faveur des amis, des associés, des compagnons, des confrères et des collègues, des domestiques eux-mêmes, l’étendre encore. Il est bon que l’homme sache que sa pensée et son souvenir ne mourront pas : aussi bien n’est-ce pas l’hérédité qui rend les fortunes inégales, elle ne fait que les transmettre. Faites la balance des produits et des services : vous n’aurez rien contre l’hérédité...” [7]
________
________
Voilà ce que me rapporte la vulgarité ambiante à ce propos :
“Ah ! Il y a des problèmes ? Je ne vous dis pas le contraire. Mais des problèmes, il y en a toujours eu, n’est-ce pas ? C’est bien connu : la perfection n’est pas de ce monde ; et qui veut faire l’ange fait la bête. Soyons réalistes avant tout...
•••
La Famille, ce que j’en pense ? Là-dessus, faut distinguer : ya Moi, et ya les Gens ; c’est important.
- Moi, ça va à peu près, même si ça pourrait aller mieux. Mais au moins je sais me tenir, et je suis à cheval sur la moralité. Tenez : si on voulait toucher à ma bagnole, on aurait à qui causer ! Et que ma femme puisse me planter des cornes, ce n’est même pas la peine d’y penser : elle sait trop de quoi je serais capable...
- Les Gens, eux, c’est pas tout à fait pareil, malheureusement, si je puis dire, et sans me vanter. Je vois pas mal de laisser-aller à l’heure d’aujourd’hui. Pour commencer, les Gens n’éduquent plus leurs gosses comme il faut, et ça donne ce qu’on voit. Si on continue sur cette mauvaise pente, faudra bien que les Autorités donnent un sérieux tour de vis, ça c’est certain.
•••
La Femme, vous dites ? Sur cette question, faut reconnaître qu’y a eu d’énormes progrès de faits, c’est la première chose. Chez nous, Dieu merci, la femme est libre. Cela saute aux yeux : les filles ont droit à l’instruction tout comme les garçons, la femme vote comme l’homme, et la mère peut prendre la pilule... On ne peut pas en dire autant partout, il y en a même qui en sont loin. Tenez : les femmes arabes !
Bien sûr, même chez nous, il y a encore des choses à faire. À condition, évidemment, de ne pas tomber dans les exagérations des féministes ! La femme doit rester la Femme !
Mais je ne fais pas de politique. Ce que je sais, c’est que mes femmes n’ont jamais eu à se plaindre. Ma dernière peut vous le dire…
•••
Vous me relancez sur le Patriarcat ! Voulez-vous dire que la femme est dominée par l’homme ? Vous rigolez ! C’est bien plutôt elles qui nous mènent par le bout du nez. Vous connaissez le proverbe : “Ce que femme veut...”. Elles arrivent toujours à leurs fins, va ! Elles connaissent nos points faibles, et elles sont bien plus malignes que nous. L’ignorez-vous ? ”
Freddy Malot – février 1998
________
La “laïcité”, philosophiquement, ça ne m’excite pas des masses. Avec elle, je reste même furieusement sur ma faim spirituelle. Pourtant, il est dit que c’est le summum du raisonnable, de la tolérance. Qu’est-ce qui se passe donc en moi ?
– Suis-je frigide ? me dit ma sœur, harcelée par la meute des mecs hypervirils, à commencer par son Jules.
– Ça n’a pas l’air, ma sœur, réponds-je. D’abord, qu’est-ce que tu appelles frigide. Et même si ! c’est pas mortel ! Faudrait pas en faire un plat !
– Rigole pas, qu’elle me répond à son tour. C’est grave. Mon mec n’arrête pas de me répéter : “y’a rien de meilleur que le sexe, faut pas s’en priver ; si tu voulais, on pourrait faire des tas de choses. Pourquoi tu rechignes à chaque fois. T’es coincée, ou quoi ?” ... Dis-moi, frangin, qu’est-ce que je peux dire contre ça ; c’est sans réplique. Et pourtant, dès qu’il me ressort ce truc, je me sens encore plus frigide ! Faut que j’aille voir un psy. J’ai même bien peur de finir en neuro avec cette histoire. Tu sais, ma copine Josette ? Elle est passée par tout ça. Je ne peux pas juger sur un cas, mais pour elle ça a pas été la joie. J’ai peur. Excuse-moi, aujourd’hui j’ai besoin de causer. Je te raconte.
Dès que Josette ouvrit la porte de son psy, il a commencé à lui écorcher tant et plus son conscient. Et il l’a pas lâchée tant qu’elle n’a pas atteint le stade schizo. Alors, elle a fini par craquer, lui avouant qu’elle se réveillait la nuit en hurlant, parce qu’elle avait un autre Moi qui la pourchassait en ricanant : t’es fichue, avorton, t’auras jamais de phallus ! À ce moment, bizarrement, son psy a abandonné un instant son air grave habituel et lui dit en souriant : tout va bien ! Nous avons fait un grand pas. Maintenant, va falloir, avec mon aide, vous atteler à la grande tâche : le curetage de votre inconscient, sur lequel, enfin, vous avez mis le doigt. Ce fut le calvaire. Le surmoi de Josette était très coriace, il s’acharnait terriblement. Faut le savoir : l’inconscient, c’est du chiendent. Celui de Josette repoussait dix fois plus vite qu’elle ne pouvait l’arracher.
Finalement Josette, hagarde et couverte de poils mâles qui poussaient tout blancs mais toujours privée de verge s’est retrouvée en neuro. Pauvre Josette ! Charybde et Scylla, on peut dire qu’elle, elle a connu. C’était à croire, maintenant, que tout Rhône-Poulenc et l’Institut Mérieux ne travaillaient que pour elle. C’étaient comme des trains de médics qui arrivaient pour lui bourrer l’œsophage. Josette en devint comme une poivrotte, elle ne pouvait plus faire deux pas sans se tenir au mur. À un moment, Josette crut que l’infirmière, sans le faire exprès, lui avait fait déglutir les cachets avec l’emballage alu et que, par-dessus le marché, la croix verte d’une enseigne de pharmacie lui avait été enfilée entre la panse et le thorax. Le total semblait coincé à l’entrée du duodenum, et lui tailladait sans répit l’estomac. En tous cas, elle crachait bel et bien du sang. À ce moment-là, je suis tombée enceinte de mon deuxième. On s’est perdues de vue. Je me demande ce qu’elle est devenue, la Josette. Je suis bien inquiète.
Mais il faut maintenant que je pense à moi. Faut pas que je déraille moi aussi. Et faut que je décide quelque chose. ça peut plus attendre. Peut-être bien que je devrais tout de suite bifurquer chez Moon. Je les ai vu à la télé, les moon, sous le soleil, au milieu des moutons. Là-bas, ils ont l’air tranquilles. Je n’y ai pas vu de psys laïcs, ces maniaques de la culpabilisation didactique. Je n’y ai pas vu non plus d’apothiquaires laïcs, ces obsédés de l’hibernation chimique. Bien sûr, ils ont l’air un peu évaporés, les moon. Mais tranquilles. D’ailleurs, j’ai l’air de quoi, moi, quand je me regarde en-dedans ? Et qu’est-ce que j’ai à perdre ? Pourquoi j’irais pas me fourrer dans leur ghetto tranquille ? Au moins, évaporés ou pas, il ont l’air de se tenir chaud ensemble. Et on voit bien que ça les soulage vraiment, de dire sans le dire que c’est les autres qui vont pas bien. Qu’est-ce que je risque d’essayer ? Ah, je partirais tout de suite, si fallait pas lâcher mon Cesare – c’est mon Jules – et surtout les deux petiots Lombroso [8]. Qu’est ce qu’ils deviendront sans moi ? Qu’est-ce que je dois faire, frérot ? Dis-moi.
– Je sais pas trop, petite sœur. C’est pas facile à décider. Sincèrement, je te vois pas aller vraiment mal. Et je mettrais ma main à couper que tu es tout à fait normalement chaude. Vrai aussi qu’il faut pas écouter les boniments des gros porcs pornos. Fais quand même gaffe au gourou, si tu vas chez les moon.
Extrait de La Laïcité débusquée, Freddy Malot – octobre 1997
________
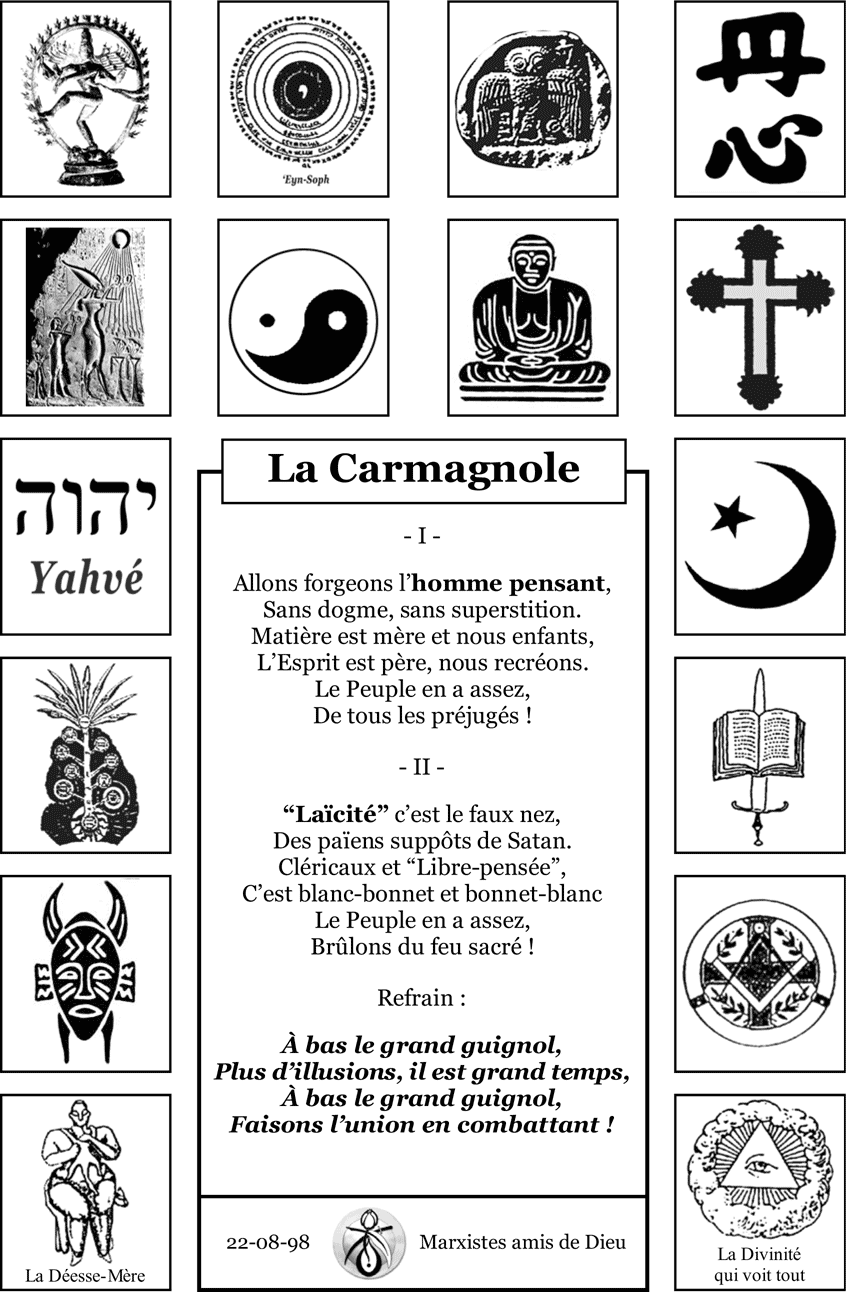
________
[1] Titre de l’édition. (nde)
[2] Telle était notre formulation à l’époque (mars 1999).
Aujourd’hui, nous disons le contraire : A. Comte = Libre-Penseur ; P.J. Proudhon = Clérical. (nde)
[3] “La famille… radical de la nation, telle est la base ou matière première de l’État” (France et Rhin, éd. Lacroix, p. 13).
[4] De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 11ème étude, Amour et mariage, éd. Rivière, t. IV, p. 277. – Cf. infra, p. 420.
[5] Id., p. 271. Proudhon insiste longuement sur le caractère subordonné, auxiliaire de la femme par rapport à l’homme, p. 271-275.
[6] De la justice, t. IV, p. 278.
[7] De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 11ème étude, Amour et mariage, éd. Rivière, t. IV, p. 283.
[8] Cesare Lombroso (1836-1909) : criminaliste italien, archi-célèbre à son époque. En 1896, il écrit à propos de la femme “normale”: “L’amour chez les femmes n’est pas autre chose au fond qu’une face secondaire de la maternité. La femme est naturellement et organiquement monogame et frigide. Le grain de beauté doit s’ajouter aux caractères de dégénérescence de la femme. La femme sent moins que l’homme, de même qu’elle pense moins. Ceci étant, ce dont il faut s’étonner, c’est que la femme ne soit pas encore moins intelligente qu’elle ne l’est”.
Nous vous rappelons que nous vivons en pays occupé :
"Les murs ont des oreilles...".